

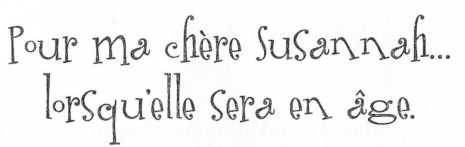

Tout d’abord et comme toujours, je voudrais témoigner toute mon admiration et ma reconnaissance à Jodi Anderson.
Après quatre livres et six ans à travailler main dans la main, je remercie toujours plus chaleureusement l’équipe qui m’accompagne chez Random House : Wendy Loggia, Berverly Horowitz, Chip Gibson, Judith Haut, Kathy Dunn, Marci Senders,
Daisy Kline, Joan DeMayo et beaucoup d’autres qui se sont investis de tout cœur dans ce projet.
Je remercie Leslie Morgenstein et mon amie et agent, Jennifer Rudolph Walsh.
Nous avons tous passé de merveilleux moments ensemble.
Merci à mes parents, Jane Easton Brashares et William Brashares, ainsi qu’à mes frères, Beau, Justin et Ben Brahsares.
On ne choisit pas sa famille, paraît-il, mais c’est eux que j’aurais choisis.
Enfin tout mon amour va à mon mari Jacob Collins et à nos trois enfants, Sam, Nate et Susannah.
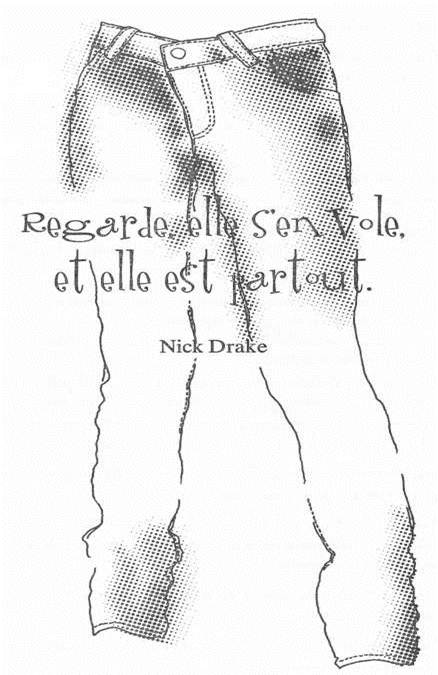
Pacte du jean magique
Nous établissons par le présent acte les règles régissant l’utilisation du jean magique :
1. Il est interdit de le laver.
2. Il est interdit de le retrousser dans le bas. Ça fait ringard. Et ça fera toujours ringard.
3. Il est interdit de prononcer le mot G-R-O-S-S-E lorsqu’on porte le jean. Il est même interdit de se dire qu’on est G-R-O-S-S-E quand on l’a sur soi.
4. Il est interdit de laisser un garçon retirer le jean (mais il est cependant possible de l’ôter soi-même en présence dudit garçon).
5. Il est formellement interdit de se décrotter le nez lorsqu’on porte le jean. Il est toutefois toléré de se gratter discrètement la narine.
6. A la rentrée, il faudra respecter la procédure suivante pour immortaliser l’épopée du jean magique :
7. Sur la jambe gauche du jean, vous décrirez l’endroit le plus chouette où vous êtes allée avec :
- Sur la jambe droite, vous raconterez le truc le plus important qui vous est arrivé alors que vous le portiez ( « Par exemple : Un soir où j’avais mis le jean magique je suis sortie avec mon cousin Ivan. » )
- Vous devez écrire aux autres durant l’été, même si vous vous amusez comme une folles dans elles.
8. Vous devez leur passer le jean suivant le protocole établi. Toute entorse à cette règle sera sévèrement sanctionnée à la rentrée ( par une fessée déculottée ! ).
9. Il est interdit de porter le jean en rentrant son T-shirt à l’intérieur (cf. règle n.2).
10. Rappelez-vous que ce jean symbolise notre amitié. Prenez-en soin. Prenez soin de vous.

Il était une fois quatre filles. Quatre jeunes femmes, pourrait-on même dire. Qui, bien que leurs vies aient toutes pris des directions différentes, s’aimaient toujours beaucoup.
Il était une fois, bien avant cela, un jean que les filles avaient découvert par hasard et baptisé le «jean magique» car il était imprégné de sagesse et de magie.
Grâce à son pouvoir, il avait su leur apprendre à vivre chacune leur vie. À devenir quatre personnes distinctes plutôt qu’une seule. À être ensemble où qu’elles se trouvent. À s’aimer elles-mêmes autant qu’elles s’aimaient les unes les autres. Et, de façon plus pragmatique, il avait le pouvoir de leur aller à toutes les quatre, ce qui était pourtant difficile à croire, surtout que l’une d’entre elles (la blonde) avait la silhouette d’un top model.
OK. Bas les masques. Je suis l’une de ces filles. Et les autres sont mes amies. Je porte ce fameux jean. Je connais son pouvoir.
En fait, je suis la blonde. Le coup du top model, c’était une blague.
Enfin bref, comme cela peut arriver dans tous les contes de fées, ce jean magique en a fait un peu trop. Et les filles, ces filles hors du commun (si vous me permettez de dire ça), ont trop bien retenu la leçon.
En ce dernier été, alors que la vie des filles changeait du tout au tout, le jean se devait de changer, lui aussi.
C’est ainsi que commence cette histoire, et elle n’est pas près de finir...

Chez Gilda, rien n’avait changé. Tout était toujours pareil. «Tant mieux», se surprit à penser Lena. Quel soulagement de pouvoir compter sur l’immuable vanité de l’homme qui perpétuait le succès de l’aérobic et rendait indispensables matelas et miroirs.
Car une pareille constance était rare. Les choses changeaient, disparaissaient.
Carmen, par exemple, n’était pas là.
- Je ne vois pas comment on va faire sans elle, remarqua Tibby.
Comme le voulait la coutume, elle avait pris sa caméra vidéo pour la postérité, mais elle n’avait rien filmé. Personne ne savait quand commençait la postérité - si ça se trouve, c’était maintenant.
- On devrait peut-être annuler, proposa Bee. Attendre d’être toutes les quatre.
Lena avait apporté les bougies, mais ne les avait pas allumées. Tibby avait pensé à l’atroce musique de gym des années quatre-vingt - qui faisait partie intégrante du cérémonial -, mais n’avait pas mis la cassette dans le poste. Bee avait courageusement disposé les crocodiles et les trucs apéritifs au fromage dans des bols, mais personne n’y avait touché.
- Et ce sera quand ? demanda Tibby. Franchement, on essaie de se voir toutes les quatre ensemble depuis septembre dernier et je crois qu’on n’a pas réussi une seule fois.
- Si, à Thanksgiving, rappela Lena.
- Mais non, tu sais bien que j’ai dû aller à Cincinnati pour les cent ans de mon arrière-grand-mère Felicia, répliqua Tibby.
- Ah oui ! et elle a eu une attaque.
- Oui, enfin, après la fête.
- Carmen est partie en Floride à Noël, reprit Lena. Et toutes les deux, vous étiez à New York pour le Nouvel An.
- Bon, et si on disait pas le week-end prochain, mais celui d’après ? Carmen sera rentrée d’ici là, non ?
- Oui, mais mes cours commencent le 20 juin.
Lena replia ses jambes contre elle, ses grands pieds bien à plat sur le parquet poisseux.
- Je ne peux pas manquer le premier jour de modèle vivant, sinon je vais me retrouver au fond de l’atelier et je ne verrai que la pointe de son genou pendant un mois.
- Bon, d’accord, alors pour le 4 Juillet, proposa Tibby après réflexion. Personne n’a cours ni rien ce vendredi-là. On pourrait se retrouver ici pour un week-end prolongé.
Bee défit ses lacets.
- Je prends l’avion pour Istanbul le 24 juin.
- Si tôt ? s’étonna Tibby. Tu ne peux pas décaler un peu ?
Le visage de Bridget s’assombrit.
- Ils nous ont réservé un vol charter, sinon c’est mille dollars de plus et il faut se débrouiller par ses propres moyens.
- Comment Carmen a-t-elle pu nous faire faux bond ? se lamenta Tibby.
Lena comprenait ce qu’elle voulait dire. C’était déjà étonnant que l’une d’elles manque ce rituel, et en particulier Carmen qui y attachait tant d’importance autrefois.
Bee balaya la salle de gym du regard.
- Elle ne rate pas grand-chose, de toute façon, remarqua-t-elle dans un esprit de conciliation, plus que de provocation. Ce n’est pas une vraie cérémonie.
Elle désigna le jean magique, soigneusement plié au milieu de leur triangle.
- Enfin, pas officielle. On a porté le jean toute l’année. Ce n’est pas comme les autres étés où on célébrait le début des vacances, et tout.
Lena ne savait pas si cette constatation devait la rassurer ou la contrarier.
- Oui, peut-être, convint Tibby. Ce n’est peut-être pas la peine de faire une cérémonie cet été.
- On devrait au moins en profiter pour fixer le roulement, dire qui l’aura et quand, intervint Lena. Carmen n’aura qu’à faire avec.
- Pourquoi on ne continue pas comme maintenant? suggéra Bridget en étendant les jambes. Pas la peine de changer parce que c’est l’été.
Lena se mordilla la peau du pouce, pesant le pour et le contre.
Autrefois, l’été, ce n’était pas pareil. C’était le moment où elles quittaient la maison, où elles se séparaient pour vivre leur vie chacune de leur côté pendant dix longues semaines. Elles comptaient alors sur le jean pour maintenir le lien jusqu’à leurs retrouvailles. Désormais, l’été, c’était comme durant toute l’année. Se retrouver séparées n’était plus une exception, conclut Lena, c’était la règle.
«Quand serons-nous de nouveau toutes réunies à la maison?» C’était ce qu’elle se demandait.
Mais, en y réfléchissant bien, elle se rendit compte que ce n’était pas tant la réponse qui avait changé, mais la question. Que recouvraient les mots «à la maison » à présent ? Quelle était la norme, le repère ? « À la maison » était un temps révolu.
Personne ne grignotait les crocodiles. Lena se dit qu’il fallait au moins en manger un, sinon elle allait fondre en larmes.
- Bon, alors on conserve le même roulement, fit-elle d’un ton las. C’est à moi de l’avoir, je crois.
- J’ai tout mis par écrit, annonça Tibby.
- OK.
- Bon...
Lena regarda l’heure.
- On y va, alors?
- Ben, ouais..., répondit Tibby.
- Vous voulez passer manger un morceau chez Dizzy, en rentrant ? proposa Bridget.
- Ouais, acquiesça Tibby, consciente des effets que pouvait avoir cette cérémonie avortée sur leur moral. Et on pourrait aller voir un film après. Je ne me sens pas de taille à affronter mes parents ce soir.
- À quelle heure vous partez, demain ?
- Notre train doit être à dix heures.
Lena et Tibby voyageaient ensemble : Tibby se rendait à New York pour commencer ses cours de cinéma et son job chez Videoworld, tandis que Lena retournait à la fac de Providence où elle devait changer de chambre pour l’été. Bee restait un peu à la maison avant de partir en Turquie.
Lena réalisa qu’elle n’avait pas très envie de rentrer chez elle non plus.
Elle ramassa le jean et le serra brièvement contre elle. Elle n’aurait su nommer ce qu’elle éprouvait, mais il s’agissait d’un sentiment que le jean n’avait jamais suscité en elle jusque-là. Elle avait ressenti de la gratitude, de l’admiration, de la confiance. À présent, tout cela se mêlait dans son cœur, teinté d’une légère pointe de désespoir.
«Je ne sais pas ce qu’on ferait sans lui», se surprit-elle à penser alors que Bee refermait la porte de chez Gilda et qu’elles descendaient lentement les escaliers dans le noir.

C’est tellement beau, Carmen. J’ai hâte que tu voies ça.
À l’autre bout du fil, Carmen hocha la tête. Sa mère avait l’air tellement heureuse qu’elle se devait de l’être aussi. Comment pouvait-elle ne pas partager sa joie?
- Vous pensez emménager quand ? demanda-t-elle d’un ton qu’elle voulait léger.
- Eh bien, il y a encore des travaux à finir. Plâtre, peintures, sols. Et puis un peu de plomberie et d’électricité. On voudrait avoir avancé au maximum avant d’emménager. J’espère que ce sera vers la fin août.
- Waouh! Si vite!
- On a cinq salles de bains, nena. Tu imagines ? Et un beau jardin à l’arrière où Ryan pourra courir.
Carmen pensa à son petit frère. Il savait encore à peine marcher, alors courir... Il aurait une vie tellement différente de la sienne.
- Alors l’appart, c’est fini ?
- Il était très bien pour nous deux, mais on a toujours eu envie d’habiter une maison, non ? Ce n’est pas ce que tu voulais, hein ?
Carmen voulait aussi avoir un frère ou une sœur. Et que sa mère ne soit plus seule. Mais une fois qu’on avait obtenu ce qu’on voulait, ce n’était pas toujours évident.
- Il va falloir que je fasse mes cartons, réalisa-t-elle.
- Tu auras une chambre plus grande dans la nouvelle maison, s’empressa de dire sa mère.
Oui, c’était sûr. Mais n’était-il pas un peu tard pour tout ça ? La chambre plus grande et la maison avec jardin ? Elle ne pouvait pas revivre son enfance. Elle avait eu l’enfance qu’elle avait eue, dans sa petite chambre, dans leur petit appartement. Ça lui faisait un drôle de pincement au cœur de laisser cette vie-là derrière elle. Il était trop tard pour la remplacer.
Comment allait-elle s’y retrouver ? Elle quittait son ancienne vie sans en avoir vraiment de nouvelle. Elle flottait donc quelque part entre les deux. De toute façon, tout ça lui semblait trop parfait.
- Lena est passée nous voir hier. Elle a apporté un Frisbee à Ryan, précisa sa mère, un peu mélancolique. J’aimerais que tu sois là.
- Ouais, mais j’ai tellement de choses à faire ici.
- Je sais, nena.
Alors qu’elle venait juste de raccrocher, le téléphone sonna à nouveau.
- Carmen, qu’est-ce que tu fabriques ?
Julia Wyman paraissait agacée. Carmen se retourna pour voir l’heure.
- On était censés faire une répétition générale avec le décor à... maintenant !
- J’arrive, fit Carmen en remontant ses chaussettes, le combiné coincé sous le menton. J’arrive tout de suite.
Elle se rua hors de sa chambre et fonça au théâtre. En chemin, elle se souvint qu’elle avait les cheveux sales et qu’elle voulait changer de pantalon parce que celui-ci la grossissait particulièrement. Mais de toute façon, qu’est-ce que ça pouvait bien faire ? Personne ne la regardait.
Julia l’attendait dans les coulisses.
- Tu peux m’arranger ça ?
Pour ce rôle, elle portait une longue jupe en tweed qui était trop grande pour elle.
Carmen se pencha pour rajuster l’épingle de nourrice à la taille.
- C’est mieux comme ça ?
- Parfait. Merci. J’ai l’air de quoi ?
Ça lui allait à merveille. Tout lui allait à merveille, elle n’avait pas besoin que Carmen le lui dise. Mais elle le fit quand même. D’une certaine façon, c’était le rôle de Julia d’être jolie pour deux et le rôle de Carmen de l’en assurer.
- Je crois que Roland t’attend sur scène.
Carmen le rejoignit, mais il n’avait pas particulièrement l’air de l’attendre. Il ne montra aucune réaction en la voyant. Ces derniers temps, elle avait l’impression de produire sur les gens autant d’effet qu’un fantôme : personne ne la remarquait, mais l’air se rafraîchissait brusquement. Elle plissa les yeux, tentant de se faire toute petite. Elle n’aimait pas monter sur scène lorsque les lumières étaient allumées.
- Tu as besoin de quelque chose? demanda-t-elle.
- Ah oui...
Il essayait de se souvenir.
- Tu peux réparer le rideau du petit salon ? Il se décroche.
- Oui, bien sûr, répondit-elle avec empressement en se demandant si elle aurait dû se sentir coupable.
Était-ce elle qui l’avait accroché ?
Elle installa l’escabeau, monta trois marches et plaqua l’agrafeuse contre la paroi de contreplaqué. Les décors de théâtre ont cela d’étrange qu’ils sont conçus pour donner une impression précise, vus d’un certain angle uniquement, et qu’ils ne sont pas faits pour durer. Ils existent dans un temps et un espace donnés, non en tant qu’objet mais en tant qu’illusion.
Elle aimait le tchak ! de l’agrafe qui mordait le mur. Voilà au moins une chose qu’elle avait apprise à l’université : à se servir d’une agrafeuse. Son père payait une fortune pour ça.
Mais ce n’était pas tout, elle avait également appris à prendre huit kilos en mangeant l’infâme nourriture de la cafétéria et en grignotant du chocolat durant de longues soirées solitaires. À devenir invisible aux yeux des garçons. À ne pas se réveiller à temps pour le cours de psycho de neuf heures. À porter presque exclusivement de grands sweat-shirts parce qu’elle avait honte de son corps. À esquiver les gens qu’elle aimait. À devenir invisible aux yeux du monde, y compris d’elle-même.
C’était un miracle qu’elle ait fait la connaissance de Julia. Carmen avait beaucoup de chance, elle le savait. Parce que Julia était la personne la plus en vue de la fac. Cela faisait donc un équilibre. Sans elle, Carmen aurait sans doute complètement disparu du campus de l’université Williams.
De : Beezy3@gomail.net
Objet : L’hiver est fini !_
Nous souffrons actuellement d’un manque drastique de Carmen dans la région.
Je sais bien que tu hibernes et je suis bien placée pour te comprendre.
Mais on est en juin, Carmen ! Il est temps de sortir de ton trou pour retrouver tes amies qui t’aiment.
Nous sommes allées chez Gilda, mais nous n’avons pas pu faire la cérémonie du jean magique sans toi. Impossible.
Bee l’abeille
Ça changeait beaucoup de choses d’être une «fille qui a un petit ami».
Bridget méditait là-dessus en rentrant de chez Lena. Cette pensée lui était venue quelques minutes plus tôt lorsqu’un type qu’elle connaissait vaguement du lycée s’était penché par la fenêtre de sa voiture pour crier : «Salut, la bombe ! » en lui envoyant un baiser.
Autrefois, elle lui aurait sans doute répondu. Peut-être même rendu son baiser. Ou alors fait un geste plus grossier, selon son humeur. Mais maintenant qu’elle était une «fille qui a un petit ami», c’était différent.
Elle avait mis presque un an à s’habituer à cette idée. C’était encore plus difficile quand on ne voyait ce petit ami qu’une ou deux fois par mois - il était à la fac à New York et elle à Providence, dans l’État de Rhode Island. L’éloignement rendait ce statut encore plus théorique. En voyant ce type qui vous hélait de sa voiture, en croisant tous ces garçons qui vous toisaient dans les couloirs du département de première année de psycho, on pensait : «Ce qu’il ignore, c’est que j’ai un petit ami.»
Chaque fois qu’elle voyait le visage si charmeur d’Eric, chaque fois qu’il apparaissait à la porte de sa chambre d’étudiante ou qu’il venait la chercher à Port Authority à New York, tout lui revenait en mémoire. La manière dont il l’embrassait. Sa capacité à veiller la moitié de la nuit pour lui faire réviser son exam d’espagnol. Jusqu’à sa façon si sexy de porter son jean.
Mais tout redevint théorique lorsqu’il lui apprit qu’il partait au Mexique. Il avait obtenu un job comme directeur adjoint au camp de foot de Bahia, où ils s’étaient connus.
- Je pars pile le jour de la fin des cours, lui avait-il annoncé au téléphone en avril.
Il n’y avait pas la moindre incertitude ni la moindre note d’interrogation, cela n’appelait pas l’approbation. Elle n’avait rien à dire.
Elle serra le combiné un peu plus fort, sans vouloir laisser paraître les sentiments chaotiques qui l’envahissaient. Elle n’aimait pas qu’on l’abandonne.
- Tu reviendras quand ?
- Fin septembre. Je vais passer un mois chez mes grands-parents à Mulege. Ma grand-mère a déjà commencé à cuisiner.
Il ponctua la phrase d’un petit rire léger, supposant qu’elle se réjouissait de son bonheur. L’idée qu’elle puisse mal le prendre ne l’effleurait même pas.
Parfois, il arrive qu’on raccroche le téléphone avec le cœur meurtri, sachant que ça fait mal sur le coup et que ça va faire encore plus mal après. La conversation n’a pas pris le tour qu’on souhaitait et pourtant on n’a aucune envie qu’elle s’achève sur cette note. Bridget avait envie de jeter le téléphone contre le mur. Et elle avec.
Elle s’était imaginé que d’une façon ou d’une autre ils auraient des projets communs pour l’été. Elle pensait que lorsqu’on avait un petit ami, on planifiait tout ensemble, en toute harmonie. Était-ce parce qu’il était tellement sûr de ses sentiments qu’il la quittait si facilement ou était-ce au contraire une marque d’indifférence ?
Elle partit courir un long moment pour tenter de se calmer. Ce n’était pas comme s’ils étaient mariés ou quoi. Elle ne devait pas mal le prendre. Elle savait que cela n’avait rien de personnel. Ce poste de directeur adjoint était une aubaine - c’était bien payé et ça le rapprochait de sa famille.
Elle n’était pas vraiment vexée ni blessée mais, dans les jours qui suivirent cette annonce, elle retrouva cette impatience, cet afflux d’énergie qu’elle connaissait bien. Elle ne voulait surtout pas se laisser dépérir sans lui. Si elle n’avait pas été aussi surprise, prise de court par cette nouvelle, elle aurait sûrement réfléchi un peu avant de s’inscrire pour ce chantier de fouilles en Turquie.
Eric ne croyait tout de même pas qu’elle allait rester assise là à l’attendre. Elle en était parfaitement incapable. Comment pouvait-elle se mettre dans la tête qu’elle avait un petit ami s’il quittait le pays de mai à octobre ? Pouvait-on encore appeler ça un couple ? Elle n’était pas du genre à se contenter d’une relation «théorique».
Ce n’est qu’après cette conversation téléphonique qu’elle avait commencé à réfléchir à tout ça. Elle avait maintenant l’impression, chaque fois qu’elle croisait un garçon en se rendant en cours, que son statut de «fille qui a un petit ami» était une contrainte plutôt qu’une fierté.
Tibby consulta l’heure qui s’affichait sur sa caisse. Son service prenait fin dans quatre minutes et il restait au moins douze personnes dans la queue.
Elle scanna une pile de six films pour une fille prépubère qui portait des paillettes argentées sur les paupières et un collier ras du cou qui l’étranglait à moitié. Elle commençait même à avoir les yeux exorbités, non?
- Tu vas regarder tout ça ? lui demanda distraitement Tibby.
On était vendredi. Les indemnités de retard atteignaient des sommets le lundi. La fille mâchait un chewing-gum qui empestait l’arôme de melon synthétique. En la voyant avaler sa salive, Tibby pensa aux pélicans auxquels les pêcheurs passent un anneau autour du cou pour les empêcher d’avaler leur prise.
- Je fais une soirée pyjama, expliqua-t-elle. On va être au moins sept. Enfin, si Callie vient. Sinon ce n’est pas la peine que je prenne celui-là, y a qu’à elle que ça plaît.
«Est-ce qu’on était comme ça?» se demanda Tibby tandis que la fille listait les goûts cinématographiques de chacune de ses amies.
Plus que deux minutes et son service serait fini. Tibby se maudit d’avoir engagé la conversation. Elle oubliait toujours que, lorsqu’on pose une question, les gens ont malheureusement tendance à répondre.
Elle avait encore onze clients à servir avant de pouvoir fermer sa caisse et, désormais, elle travaillait pour la gloire.
- Je ferme, annonça-t-elle à une douzième personne qui s’approchait avant qu’elle ne perde du temps dans sa file.
Le client suivant était un jeune homme avec un bouc qui portait un coupe-vent par-dessus son uniforme de vigile.
Lorsqu’il s’entrouvrit, Tibby put voir qu’il s’appelait Cari. Elle avait envie de lui dire qu’il avait fait un bon choix, mais que la fin était nulle et que le numéro 2 était une calamité, cependant elle se contenta de le penser sans l’énoncer à voix haute. Dorénavant, elle se plierait à cette règle. Car, pour tout avouer, elle préférait parler qu’écouter.
Elle ferma sa caisse, dit au revoir, descendit Broadway avant de tourner sur Bleecker Street où se trouvait son foyer d’étudiants. L’inconvénient de son boulot, c’était qu’elle touchait à peine plus que le salaire minimum. L’avantage, c’est qu’elle était à cinq minutes à pied.
Il faisait frais dans le hall d’entrée désert - mis à part le vigile à son bureau. Rien à voir avec l’atmosphère survoltée qui y régnait durant l’année universitaire. Plus d’étudiants en grande discussion, plus de symphonie de sonneries de portable. Un mois plus tôt, le panneau d’affichage était couvert de petites annonces, maintenant le liège était nu.
D’habitude, prendre l’ascenseur était une véritable épreuve. Tout ce temps pour fixer, toiser et juger. Dans cet espace bien entendu bondé, elle se souciait de ce que pensait d’elle chacun de ses compagnons de voyage, même ceux dont elle ne connaissait pas le nom. Mais dans l’ascenseur vide, elle avait l’impression de se fondre dans les panneaux en faux bois.
Ce soir, les couloirs seraient déserts. Le programme d’été ne commençait qu’après le 4 juillet. Et même ensuite, il n’y aurait que des nouveaux, des gens de passage, aucun de ses amis, et pas le genre de personnes dont elle se souciait dans l’ascenseur. Ils seraient repartis à la mi-août.
C’était ça qui était bizarre à la fac. On avait l’impression qu’on était censé y découvrir sa vie. À chaque personne qu’on croisait, on se demandait : « Est-ce qu’elle va être importante pour moi ? Va-t-elle jouer un rôle dans ma vie et moi dans la sienne ? » Elle s’était fait quelques amis à son étage et dans ses cours, mais elle savait que, hors de ce cadre, la plupart de ces personnes ne seraient rien pour elle. Comme les filles de l’équipe de natation qui se maquillaient le visage en violet, aux couleurs de la fac, ou ce type à la pilosité galopante qui portait un T-shirt Warhammer.
Une fois de plus, dans sa tête résonna la voix qu’elle avait récemment surnommée Méta-Tibby (la voix de sa conscience, juste et pondérée, jamais hargneuse) : qui aurait deviné ce fameux jour au drugstore que Brian prendrait une telle importance dans sa vie ?
Durant ces quatre dernières années, beaucoup de choses avaient changé. Alors que Brian soutenait qu’il était tombé amoureux d’elle au premier regard, elle l’avait longtemps pris pour un crétin. Elle s’était trompée. Elle se trompait souvent. Maintenant, dès qu’elle pensait à lui, elle avait une drôle de sensation au creux du ventre. Cela faisait neuf mois qu’ils... qu’ils quoi? Elle détestait l’expression «sortir ensemble». Cela faisait neuf mois qu’ils s’étaient introduits dans les locaux de la piscine municipale après la fermeture pour se baigner en sous-vêtements, s’embrasser voracement et se serrer fort fort fort jusqu’à avoir les mains et les doigts de pieds violets et les lèvres bleues.
Ils n’avaient pas encore fait l’amour. Pas officiellement, malgré l’insistance de Brian. Mais depuis cette nuit du mois d’août, elle avait l’impression que son corps lui appartenait et vice versa. Depuis cette soirée à la piscine, leur relation avait changé. Avant, ils vivaient chacun dans leur propre espace. Maintenant, ils partageaient le même. Avant, si sa cheville frôlait la sienne sous la table, elle rougissait, angoissait et trempait son T-shirt de sueur. Maintenant, une partie de leurs corps était toujours en contact. Ils Usaient ensemble sur un lit une place, pratiquement couchés l’un sur l’autre, en arrivant tout de même à se concentrer sur leur lecture. Enfin, un petit peu.
Ce soir, dans les couloirs, il n’y aurait pas un bruit. Elle finissait par regretter Bemie qui faisait des vocalises de huit à dix, et Deirdre, la seule à cuisiner vraiment dans la kitchenette commune. En même temps, c’était reposant de se retrouver seule. Elle allait pouvoir envoyer des mails à ses amies et se raser jambes et aisselles avant l’arrivée de Brian, le lendemain. Et elle commanderait peut-être un plat thaï au petit resto du coin. Elle irait le chercher elle-même pour éviter de payer la livraison. Elle détestait la radinerie mais elle était vraiment à cinq dollars près.
Elle glissa sa clé dans le trou qui servait de serrure. Celle-ci était tellement large et déformée qu’elle avait l’impression que n’importe quelle clé du campus pourrait l’ouvrir. Peut-être même n’importe quelle clé au monde. C’était vraiment une serrure facile, comme il y a des filles faciles.
Elle poussa la porte, appréciant comme chaque fois d’avoir une chambre seule. Peu importe qu’elle fasse deux mètres sur trois. Peu importe qu’elle ressemble davantage à un placard qu’à une véritable chambre. C’était son endroit à elle. Contrairement à chez ses parents, ses affaires ne bougeaient pas de là où elle les avait laissées.
Son regard se posa d’abord sur la diode clignotante du bouton «power» de son ordinateur, puis sur la lueur verte et fixe de la batterie de sa caméra, indiquant qu’elle était chargée. Enfin, il s’arrêta sur la pupille brillante d’un grand brun de dix-neuf ans qui était assis sur son lit.
Brusque secousse dans le ventre, les jambes, les côtes, le cerveau. Cœur qui s’emballe.
- Brian!
- Salut, fit-il tout doucement, pour ne pas lui faire peur.
Elle lâcha son sac et courut vers lui, se blottissant instantanément au creux de ses bras.
- Je croyais que tu arrivais demain.
- Je ne peux pas tenir cinq jours, lui susurra-t-il à l’oreille.
C’était tellement bon de le sentir autour d’elle. Elle adorait cette sensation. Jamais elle ne s’en lasserait. C’était trop bon. Injustement bon. Elle ne pouvait se défaire de l’idée qu’il y avait un équilibre dans la vie. Tout se payait. En termes de bonheur, cette sensation était un luxe dispendieux.
Généralement, quand les garçons disent «je te téléphone demain», ils rappellent une semaine plus tard, ou pas du tout. Généralement, quand les garçons disent «je serai là à huit heures», ils arrivent à neuf heures et quart. Ils vous mettent dans un état d’incertitude, de manque, d’attente détestable qu’ils entretiennent soigneusement. Mais pas Brian. Quand Brian disait qu’il venait le samedi, il arrivait le vendredi.
- Ah, là, je suis bien, murmura-t-il, enfoui dans son cou.
Elle regarda sa joue, son avant-bras viril. Il était tellement beau, pourtant il restait modeste. Ce n’était pas son physique qui l’attirait, mais il n’y avait pas de mal à le remarquer, si ?
Il roula sur le lit en l’entraînant. Elle ôta ses baskets sans les mains. Il releva sa chemise pour poser sa tête sur son ventre nu, enlaçant ses hanches, les genoux contre le mur. Si cette chambre était petite pour elle, Brian pouvait à peine y tenir complètement déployé. Il n’arrêtait pas de se cogner. Ce soir, elle était bien contente de ne pas avoir à se soucier de son voisin de la 11C.
C’était miraculeux, oui. Leur chambre à eux. Pas besoin de se cacher, de mentir, de faire les choses en douce. Pas de parents à qui rendre des comptes. Pas de couvre-feu à respecter.
Le temps s’étirait devant eux. Ils mangeraient ce qu’ils voulaient pour le dîner - enfin, du moins, ce qu’ils pouvaient se payer. Elle se souvenait du soir où ils avaient chacun pris deux Snickers et de la glace en dessert. Ils s’endormiraient ensemble, sa main posée sur ses seins ou dans le creux de ses hanches et se réveilleraient ensemble, quand le soleil inonderait sa fenêtre orientée à l’est. C’était tellement bon. Trop bon. Comment se faisait-il qu’elle y ait droit?
- Je t’aime, murmura-t-il en glissant la main sous sa chemise.
Il ne marqua pas de temps d’arrêt, quémandant une réponse. Ses mains étaient déjà sur ses épaules et il levait la tête pour l’embrasser à pleine bouche. Il n’avait pas besoin de réponse.
Elle s’était toujours imaginé - une croyance sans fondement - qu’on aimait en miroir. Dans une parfaite réciprocité.
Mais Brian n’était pas comme ça. Il vivait son amour librement et sans attendre de retour. Ce qui impressionnait Tibby et le classait dans une catégorie à part - comme les gens qui parlaient mandarin ou savaient faire un dunk au basket.
Elle plongea sa main sous son T-shirt, parcourant son dos chaud, ses clavicules.
- Je t’aime, dit-elle.
Trois mots qu’il ne lui avait pas réclamés, mais qu’elle lui donnait quand même.

Il y a tant de choses qu’on croit acquises. Tant de choses qu’on remarque à peine jusqu’au jour où l’on s’aperçoit qu’elles ont disparu. Carmen venait de réaliser qu’elle avait perdu - entre autres - son identité.
Pourtant, elle en avait bien une, avant, pensait-elle en rangeant les derniers accessoires dans le théâtre sombre et désert.
Autrefois, elle pouvait se définir comme la fille unique d’une mère célibataire. Comme l’un des quatre membres d’un quatuor inséparable. On pouvait dire d’elle qu’elle était un crack en mathématiques, une victime de la mode, une Me qui dansait bien, une maniaque qui voulait tout contrôler, une feignasse. Une habitante de l’appartement 4F. Mais tout ça, c’était fini ou - pour le moment, du moins - en sommeil. Et elle n’avait rien trouvé à mettre à la place. À part peut-être Julia. Heureusement qu’elle avait Julia.
Dans l’idéal, les gens grandissent auprès de leurs parents, puis ils partent à l’université, laissant derrière eux une famille, une maison, qui les attend. Laissant derrière eux un trou, un vide qui a plus ou moins leur taille et leur forme. Et ils rentrent de temps en temps pour remplir ce vide.
Peut-être n’était-ce qu’une illusion. Rien ne demeure figé. On ne peut pas demander aux autres de rester là, sur «pause», en attendant qu’on revienne.
II faudrait être vraiment puéril pour croire ça, même Carmen n’était pas narcissique à ce point. (Enfin, peut-être un peu, mais pas complètement.) Mais tant pis si c’était une illusion. C’est bien utile parfois, les illusions.
L’essentiel, c’était que l’endroit qu’on désignait comme «la maison» reste là où il était quand on se déplaçait. Ce qui permettait de se situer n’importe où dans le monde par rapport à «la maison» «Je suis tellement loin de la maison», pouvait-on alors se dire lorsqu’on se trouvait, par exemple, en Chine. «Je suis presque arrivé à la maison », pensait-on en l’apercevant au coin de la rue.
Comme la mère de Carmen aimait à le rappeler, les adolescents et les bébés qui commencent à marcher ont beaucoup de points communs. Ils aiment quitter leur mère à la seule condition qu’elle ne bouge pas.
Mais la mère de Carmen bougeait. Elle avait la bougeotte. Pour Carmen, «la maison» c’était une époque, plus un endroit. Elle ne pouvait plus y retourner.
Du coup, pour elle, il devenait beaucoup plus difficile de partir et de se situer dans le monde.
Durant les sept premiers mois de l’année universitaire, rien ne lui avait semblé familier, rien ne lui avait semblé réel. À part peut-être la nourriture. Elle avait l’impression d’être tombée dans une faille spatio-temporelle. Elle regardait la vie se dérouler, sans y prendre part. Elle se contentait d’attendre, en se demandant quand son existence à elle reprendrait.
Elle était pleine de vie avant. Oui, vraiment. Elle avait de l’ambition, elle était jolie. C’était une jeune femme haute en couleur. Maintenant elle avait l’impression d’être un fantôme. La nourriture pâle et pâteuse de la cafétéria la rendait pâle et pâteuse. Rendait flous les contours de sa silhouette.
Elle était trop dépendante de son environnement et de son entourage pour rester elle-même hors contexte. Les visages de ses amies et de sa mère étaient ses miroirs. Sans eux, elle ne se voyait plus, elle était perdue. Elle s’en était rendu compte lors de ce premier été si étrange, si solitaire, où elle avait fait la connaissance de la nouvelle famille de son père en Caroline du Sud.
Cet automne, elle était sortie une ou deux fois avec Win, le garçon qu’elle avait rencontré l’été dernier, mais elle avait volontairement laissé leur relation s’effilocher. Elle ne se connaissait pas, elle ne s’aimait pas assez elle-même pour lui permettre d’apprendre à la connaître et à l’aimer. Elle n’avait rien à offrir.
Il s’avéra qu’elle n’était pas très douée pour se faire des amis. C’était le problème lorsqu’on avait déjà trois amies prêtes à l’emploi dès la naissance. Elle n’avait jamais fait travailler le muscle qui sert à se faire des amis. D’ailleurs, elle en était peut-être dénuée.
Sa première erreur avait été de croire qu’avec sa compagne de chambre, Lissa Greco, elles allaient tout de suite sympathiser et que ça lui permettrait de tisser d’autres relations. Mais Lissa l’avait détrompée très rapidement. Elle était arrivée à la fac avec ses deux meilleures amies de lycée. Elle n’avait pas besoin d’une autre amie. Elle s’était montrée odieuse avec Carmen. Elle l’avait même accusée de lui avoir volé des vêtements.
Au début, Carmen se sentait perdue, toute seule. Tibby, Bee et Lena lui manquaient cruellement, elle avait envie de les voir tout le temps. Mais, au fil des mois, elle s’était mise à les éviter, habilement. Elle n’avait aucune envie de leur avouer (et de s’avouer) que sa vie à la fac n’était pas aussi merveilleuse qu’elle l’avait espéré.
Une fois, elle était allée à Providence et avait découvert Bee dans toute sa gloire, entourée de ses amies de l’équipe de foot, de sa super compagne de chambre, de ses amis de la cafét, de la bande de copains qu’elle avait rencontrés en soirée et de ses amis de la bibliothèque. Elle avait aussi vu Lena, qui menait une vie enviable dans un tout autre style. Calme, radieuse, entourée de ses magnifiques esquisses. Lorsqu’elle avait passé un week-end à New York avec Tibby, ils s’étaient retrouvés à trois dans la chambre, avec Brian, et Tibby avait glorieusement remporté un prix pour son premier court-métrage.
Carmen refusait qu’elles lui rendent visite pour être témoins de son existence sans gloire aucune. Elle ne voulait pas qu’elles la voient comme ça.
Elle avait fait la connaissance de Julia à la fin de l’hiver au département d’études théâtrales où elle était en train de s’inscrire à un cours d’écriture dramatique. Julia avait cru qu’elle s’intéressait aux aspects techniques du théâtre.
- Tu as déjà bossé sur des décors ? l’avait-elle questionnée.
Carmen n’avait pas tout de suite compris qu’elle s’adressait à elle.
- Moi? avait-elle finalement demandé.
Elle ne savait pas ce qui l’avait le plus surprise : que Julia la prenne pour une accessoiriste ou qu’elle lui adresse la parole.
«Je suis tombée bien bas», avait-elle pensé, démoralisée. L’an dernier, personne ne l’aurait prise pour une accessoiriste. Elle était l’une des filles les plus canon du lycée, surtout en terminale. Elle portait des hauts courts, nombril à Pair. Elle flirtait outrageusement. Elle avait passé ses examens avec du rouge à lèvres vraiment rouge.
Bref, devant Julia, elle avait essayé de rassembler le peu de dignité qui lui restait.
- Non, ce ne sont pas vraiment les décors qui m’intéressent.
- Oh, allez ! Tout le monde peut le faire. Jeremy Rhodes va monter Miracle en Alabama pour le festival et on n’a personne pour les décors et les accessoires.
Carmen se souvenait d’avoir croisé Julia à la cafétéria. C’était l’une des rares étudiantes de première année qui était connue sur le campus. Elle était belle, dans un style assez théâtral, justement, avec son teint pâle et ses longs cheveux noirs. Elle portait des vestes vintage sur de longues jupes de bohémienne et faisait tout un raffut avec ses badges, colliers et bracelets divers et variés. Elle était petite et mince mais parlait avec de grands gestes, comme quelqu’un qui se sait l’objet de tous les regards.
- Ah, désolée, avait fait Carmen.
- Préviens-moi si tu changes d’avis, OK ? On forme vraiment un petit groupe très cool. Très uni.
Carmen avait hoché la tête avant de filer, mais elle y avait réfléchi. Elle était assez tentée par la perspective d’avoir quelque chose à faire et des gens «très cool» avec qui traîner.
Julia l’avait à nouveau abordée à la cafét, quelques semaines plus tard.
- Salut, comment ça va ?
Carmen était gênée parce qu’elle était en train de manger. D’un côté, ça l’ennuyait que Julia la voie ainsi et, de l’autre, elle était ravie qu’on la voie avec Julia.
- Ça va, avait-elle répondu.
- Tu as été prise pour le cours d’écriture dramatique ?
- Non. Et la pièce, ça avance ?
- Super.
Julia l’avait gratifiée d’un sourire ravageur.
- Mais on cherche toujours des gens.
- Ah oui?
- Ouais. Tu devrais vraiment y réfléchir. Jeremy est super cool. Il n’y aura que trois représentations, après les examens. Tu n’as qu’à passer ce soir. On a une répétition à sept heures. Comme ça, tu verras ce que tu en penses.
- Merci, avait fait Carmen, mue par un absurde élan de reconnaissance.
Reconnaissante que Julia l’ait remarquée, se soit souvenue d’elle, lui ait parlé, l’ait invitée quelque part. Avait-elle conscience de son isolement?
- D’accord, je viendrai peut-être, avait-elle ajouté.
Elle débordait à tel point de reconnaissance qu’elle aurait sans doute accepté de boire un verre de soda chimique hautement toxique si Julia le lui avait proposé.
Et c’est ainsi que, une semaine plus tard, Carmen se retrouva perchée sur une échelle, une ceinture à outils autour de la taille. Si ses amies l’avaient vue, elles ne l’auraient pas reconnue. Aucun élève de sa classe de terminale ne l’aurait reconnue - tout du moins, elle l’espérait. En tout cas, elle, elle ne se reconnaissait pas. Mais, dans le fond, qui était-elle ? Qui était Carmen ?
Si elle l’avait su, elle n’aurait pas été perchée sur cette échelle avec cette ceinture autour de la taille.
Et voilà qu’à présent, six semaines plus tard, Carmen se retrouvait dans la même situation, sauf que cela lui semblait moins absurde. Elle se sentait davantage à sa place ici que nulle part ailleurs. On s’habitue à tout. Ou presque.
Elle était contente d’avoir quelque chose à faire, un endroit où aller après le dîner, en dehors de sa chambre. Elle était contente que Julia soit sympa avec elle. Elle lui avait présenté des gens. Elle s’assurait que, quand la troupe allait prendre un cappuccino après la répétition, Carmen vienne aussi. Carmen adorait l’hilarante imitation que Julia faisait de Lissa pour lui remonter le moral chaque fois que sa voisine de chambre lui faisait un coup bas.
Dans le groupe de théâtre, qui réunissait le gratin des étudiants, Carmen avait l’impression d’être un des accessoires de Julia, une amie «prêt-à-porter» bon marché. Elle était trop souvent obligée de rappeler son prénom. Mais tant pis. Mieux valait être l’ombre de Julia que n’être personne et rester seule dans sa chambre à manger des cochonneries.
Parfois, elle s’apitoyait sur son sort. Elle se comparait au prince dans le conte de Mark Twain, Le Prince et le Pauvre, pris pour un homme sans importance. «Avez-vous la moindre idée de qui je suis vraiment ? pensait-elle. Avez-vous la moindre idée de qui sont mes amies ? »
Mais si on l’avait accusée de bluffer, qu’aurait-elle répondu? Elle pouvait sans doute répondre à la seconde question, mais elle ne connaissait même pas la réponse à la première.
«Et toi, qu’est-ce que tu gagnes dans tout ça?» demanda-t-elle mentalement à Julia, trois semaines plus tard, alors qu’elle resserrait sa jupe pour la troisième fois et que Julia lui prenait la main pour la remercier. Ça, elle ne comprenait pas.
Lorsque Julia vint la trouver en avril avec la brochure du festival de théâtre de l’université du Vermont, Carmen fut surprise et, comme d’habitude, débordante de gratitude.
- Ils montent de véritables spectacles avec un tas d’acteurs reconnus, fit valoir Julia. Tu voudrais participer? Ça se déroule de mi-juin à la deuxième semaine d’août. Ce n’est pas facile d’être sélectionné en tant qu’acteur mais ils recrutent toujours du personnel technique. Ce serait une super expérience.
Carmen était tellement contente qu’elle pense à elle qu’elle accepta pour la seule et unique raison qu’elle le lui avait proposé. Mais par la suite, elle dut convaincre ses parents de régler les frais d’inscription.
- Depuis quand t’intéresses-tu au théâtre ? voulut savoir son père lorsqu’elle l’appela pour lui demander le chèque.
Il était dans sa voiture, elle l’avait appelé sur son portable alors qu’il rentrait du bureau.
- Depuis.., je ne sais pas... depuis maintenant.
- Mmm... c’est vrai que tu as toujours eu un certain sens théâtral, mur-mura-t-il.
- Je te remercie, papa.
C’était le genre d’affront qu’il fallait encaisser lorsqu’on réclamait de l’argent.
- Dans le bon sens du terme, je veux dire, ma petite brioche, évidemment.
- Évidemment, répéta-t-elle sèchement.
- Et je me souviens de ta fameuse performance en tant que carotte dans la pièce que tu as jouée au CP.
- Je tenais le rôle de la tomate. Mais, de toute façon, je ne jouerai pas.
- Qu’est-ce que tu vas faire, alors ?
- Œuvrer en coulisses.
- Œuvrer en coulisses ?
On aurait dit qu’elle venait de lui annoncer qu’elle allait se faire greffer une troisième oreille.
- Oui, confirma-t-elle, légèrement sur la défensive.
- Mais, Carmen chérie, tu n’as jamais supporté d’être en coulisses de toute ta vie.
Décidément, il était d’humeur taquine, remarqua-t-elle avec amertume.
- Eh bien, il est peut-être temps, répliqua-t-elle.
Elle l’entendit couper son moteur. Le silence se fit.
- Si c’est vraiment ce que tu veux, ma petite brioche, je suis tout à fait d’accord pour financer ce projet.
C’était plus simple lorsqu’il était agaçant. Quand il se montrait gentil, finalement, ça l’obligeait à réfléchir.
Que voulait-elle vraiment? Elle pensa à Julia. Ne voulait-elle pas simplement qu’on veuille un peu d’elle ?
Elle considéra les autres options qu’elle avait en stock. Bee partait en Turquie. Tibby faisait un stage à New York et Lena serait à Providence. Sa mère et David bazardaient son appartement - son « chez-elle » - pour s’installer dans une grande maison de banlieue, dans une rue dont elle n’avait jamais entendu parler.
- C’est ce que je veux vraiment, répondit-elle.
Bridget était en train de chercher une brosse à dents dans le chaos de l’armoire à pharmacie lorsqu’elle réalisa qu’elle n’avait pas dormi à la maison depuis bien longtemps.
Ce n’était pas prémédité. Juste un concours de circonstances. À Thanksgiving, elle était restée tellement tard chez Lena qu’elle s’était endormie sur le canapé. Elle avait passé les vacances de Noël à New York, d’abord dans le nord de la ville avec Eric, puis dans le centre avec Tibby. Elle était allée rendre visite à Greta dans l’Alabama pour les vacances de printemps. Et lorsqu’elle était revenue en février, elle avait dormi dans le car.
Ce n’était qu’aujourd’hui, à la veille de son départ pour un chantier de fouilles à l’autre bout du monde, qu’elle se posait à la maison.
Dans le couloir, elle évita de baisser les yeux. Elle n’avait aucune envie de remarquer que la moquette avait besoin d’un bon coup d’aspiro. Elle ne voulait pas passer le peu de temps qu’elle avait à faire le ménage.
Dans sa chambre, elle fouilla rageusement dans son grand sac marin. Elle n’avait pas envie non plus de sortir ses affaires. Elle avait une tonne de linge à laver, mais elle ne ferait pas sa lessive ici. Elle limitait ses contacts avec cette maison au strict minimum : plante des pieds et espace requis pour poser son sac. Le simple fait de devoir s’asseoir ou s’allonger lui semblait déjà trop.
Cela lui rappelait le séjour en camping qu’elle avait fait en cinquième. Un ranger leur avait exposé les principes du camping écologique : «Il faut laisser la nature dans l’état où vous l’avez trouvée en arrivant, sans trace de votre passage.» C’était ainsi qu’elle procédait dans sa propre maison. Elle mangeait davantage, buvait davantage, riait davantage, respirait davantage, dormait davantage chez n’importe laquelle de ses amies que chez elle.
Elle frappa à la porte de Perry. Une fois, deux fois. Elle savait qu’il était là. Finalement, elle poussa la porte. Il avait les yeux rivés sur l’écran de son ordinateur et un énorme casque sur les oreilles, ce qui expliquait pourquoi il ne l’avait pas entendue.
C’était une vraie manie dans la famille ! Son père et son frère ne quittaient jamais leurs maudits casques, il régnait un silence de mort dans cette maison !
- Salut ! cria-t-elle à trente centimètres de son oreille.
Il leva la tête, tout perdu, et ôta son casque. Il n’avait pas l’habitude qu’on l’interrompe.
Il était au beau milieu d’un de ces jeux de guerre en ligne qui le passionnaient depuis son entrée au lycée. Il n’avait pas la moindre envie de bavarder. Il voulait se replonger dans son univers virtuel.
- Tu aurais une brosse à dents ? Je croyais avoir apporté la mienne, mais je ne la retrouve pas.
Elle avait toujours l’impression de faire trop de bruit, de déranger, dans cette maison.
- Pardon?
- Une brosse à dents en rabe, tu aurais ?
Il secoua la tête sans même réfléchir.
- Non, désolé.
Et il se retourna vers l’écran.
Bridget dévisagea son frère. Elle pensa à Eric et réalisa soudain un certain nombre de faits indéniables. Oui, dans sa famille, ils étaient timbrés. Excentriques, si on voulait formuler les choses de façon positive. Ils n’étaient pas drôles; ils n’étaient pas proches. Quand même, elle était là, à côté de Perry, son frère - son frère jumeau, bon sang - qu’elle n’avait pratiquement pas vu depuis un an !
Elle poussa une pile de magazines d’informatique pour s’asseoir sur le bureau. Elle allait discuter avec son frère. Ils n’avaient pas eu de véritable conversation depuis Noël. Elle allait le torturer, juste pour se sentir moins coupable.
- Comment ça va, à la fac ?
Il tripota quelque chose à l’arrière de son écran.
- Tu as choisi quelles options ce semestre ? Tu as pris le cours d’observation de la nature?
Il continuait à s’agiter. Il leva un instant vers elle des yeux suppliants.
- Hé, Perry!
- Ouais. Euh, désolé.
Il lâcha enfin son ordinateur.
- J’ai pris un semestre sabbatique, expliqua-t-il au bras de son fauteuil.
- Quoi?
- Ouais, je ne vais pas en cours ce semestre.
- Et pourquoi ça?
Son regard était vide. Il n’avait pas l’habitude de devoir répondre à des questions. Il n’avait pas l’habitude de devoir se justifier ou expliquer ses décisions.
- Qu’en pense papa? demanda-t-elle.
- Papa?
- Oui.
- On n’en a pas vraiment discuté.
- Vous n’en avez pas vraiment discuté.
Elle parlait un peu trop vite, un peu trop fort. Perry serra les dents, comme si elle lui faisait mal aux oreilles.
- Il est au courant?
Son frère évitait son regard. Elle avait l’impression de parler dans des enceintes plutôt qu’à lui en particulier.
Elle se moquait qu’il refuse de la regarder. Elle, elle le fixait. Elle essayait de le voir d’une façon objective.
Il avait toujours eu les cheveux plus foncés que les siens. Maintenant ils étaient complètement bruns, sûrement parce qu’il passait tout son temps à l’intérieur. Sa lèvre supérieure était bordée de duvet mais, à part cela, il semblait à peine avoir passé l’âge de la puberté. Elle détourna les yeux, la gorge serrée.
Il était menu et elle si grande qu’on avait du mal à croire qu’ils étaient de la même famille, et encore moins jumeaux. Mais finalement ce n’était peut-être pas si étonnant que cela. Peut-être était-ce là toute l’ambiguïté d’être nés en même temps. Ce que l’un possédait, l’autre ne pouvait l’avoir. Et Bridget avait toujours été la plus solide. Elle ne pouvait s’empêcher de s’imaginer essayant de pomper le plus de ressources possibles lorsqu’ils étaient tous les deux dans le ventre de leur mère.
Comme s’il existait une sorte de mathématique des jumeaux. Si l’un des deux était intelligent, l’autre se sentait bête. Si l’un était autoritaire, l’autre était docile. L’équation était trop facile.
Bridget savait qu’elle avait pris plus que son dû. Mais était-ce son rôle de se faire petite pour l’encourager à faire sa place ? Si elle se tenait en retrait, irait-il de l’avant ? Était-ce sa faute s’il était ainsi ?
- Je crois que papa est au courant, oui, répondit-il finalement.
Elle se releva, contrariée. Que faisait-il de ses journées s’il n’allait pas en cours? Il n’avait pas de travail. Avait-il seulement des amis? Sortait-il jamais de sa chambre?
- À plus tard, lui dit-elle sèchement.
- Tu n’as qu’à lui demander.
Elle se retourna.
- À qui?
- À papa.
- Quoi?
- S’il a une brosse à dents.

Il était rare que Lena se sente seule. Il lui suffisait de savoir qu’elle avait des amies pour être heureuse. Elle n’avait pas besoin de les voir ou de leur parler tout le temps. C’était comme pour tant d’autres choses : tant qu’il y avait de l’aspirine dans l’armoire à pharmacie, elle n’avait pas vraiment besoin d’en prendre. Tant que les toilettes étaient libres, elle n’avait pas besoin d’y aller. Tant que le minimum vital était disponible, elle n’avait pas de gros besoins.
Elle réfléchissait à cela le premier jour de son stage de peinture. Elle ne connaissait ni le professeur ni l’assistant. Elle ne connaissait pas les élèves. Elle allait utiliser une nouvelle sorte de pinceau. Mais tout cela lui plairait sûrement une fois qu’elle s’y serait habituée.
En attendant, Tlbby et Carmen étaient joignables d’un simple coup de fil sur leur portable. C’était bientôt son tour d’avoir le jean magique. Annik, son ancienne prof, était à sa disposition en cas de crise artistique, même mineure. Elle avait son bon vieux pinceau à portée de main, au cas où. C’était tout cela qui lui donnait confiance en elle.
Mais pouvait-on vraiment parler de confiance en soi alors qu’elle prenait tant de précautions ?
- Par ici, il reste une place, dit Robert, l’assistant, à un retardataire.
Ce que Lena attendait des autres élèves, ce n’était ni leur amitié ni leur sympathie. C’était juste qu’ils ne s’installent pas trop près d’elle pour lui boucher la vue. Elle se raidit tandis que le nouvel arrivant approchait et se détendit à nouveau quand il passa derrière elle pour aller s’asseoir dans le fond de l’atelier. Menace potentielle écartée. Elle n’avait même pas besoin de quitter le modèle des yeux.
Quand le minuteur sonna, annonçant que le modèle allait changer de pose, Lena leva finalement les yeux. Elle aperçut des cheveux bruns qui dépassaient du chevalet du nouveau, une masse bouclée pas vraiment coiffée. C’était quelqu’un de grand, vraisemblablement de sexe masculin. Elle baissa vite les yeux. Ces cheveux lui disaient quelque chose. Elle fouilla dans sa mémoire. Sans relever la tête, elle sortit dans le couloir.
Au fil des ans, elle avait pris l’habitude d’éviter de croiser le regard des gens. C’était assez triste qu’elle ait capitulé de la sorte, car elle aimait observer leur visage. Après tout, elle voulait devenir artiste. Elle avait de bons yeux et elle aimait s’en servir. Le problème c’était que, lorsqu’elle fixait quelqu’un, cette personne la fixait aussi, forcément. Or autant elle aimait observer, autant elle détestait être observée. Niveau caractère, elle aurait parfaitement pu être invisible. Mais niveau physique, elle savait que ce n’était pas le cas. Elle avait toujours été belle. Et elle attirait les regards.
C’était une des choses qui lui plaisaient lorsqu’elle dessinait ou peignait un modèle. C’était le seul moment, dans sa vie, où elle pouvait regarder, regarder tout son soûl, sans que personne ne la regarde.
Elle retourna à son chevalet après les cinq minutes de pause, en se préparant à vingt-cinq minutes d’intense concentration. Le retardataire aux cheveux touffus était encore en train de dessiner. Cela attisa sa curiosité. Elle aperçut une main et une palette. Il s’agissait d’une main d’homme.
Pendant les premières minutes, elle pensa davantage à ces cheveux et à cette main qu’à son dessin. C’était étonnant de sa part. Peut-être évitait-elle de croiser le regard des autres, mais visiblement le mystère l’attirait tout autant que quiconque.
À la pause suivante, elle guetta le visage qui allait surgir de derrière la toile. Elle attendait qu’il la voie, qu’il la regarde. Alors la vie reprendrait son cours normal. Son regard s’attarderait quelques secondes de trop et, aussitôt, il ne l’intéresserait plus.
C’était étrange, elle avait l’impression qu’elle le connaissait.
La pause s’acheva et il n’avait pas levé les yeux de sa toile un seul instant Quelle déception ! Elle s’assit de façon à pouvoir le regarder. Non, mais elle était ridicule comme ça, à tendre le cou. En laissant échapper un petit rire, elle inspira l’odeur d’huile de lin et de peinture, une odeur synonyme de bonheur.
C’est vraiment idiot, le désir. On désire ce qu’on n’a pas et, une fois qu’on l’obtient, on n’en veut plus. On considère ce qu’on possède comme un acquis, jusqu’à ce que ce soit hors de portée. Il s’agissait, lui semblait-il, d’un des plus cruels paradoxes de la nature humaine.
Cela lui rappelait cette paire de boots à semelles compensées marron qu’elle avait repérée chez Bloomingdale’s et refusé d’acheter parce qu’elle coûtait plus de deux cents dollars. Elle s’était dit qu’ils devaient en avoir des tas en réserve. Ils n’avaient sûrement pas vendu sa pointure de géante, elle pourrait toujours revenir.
Mais quand elle était revenue, deux jours plus tard, il n’en restait plus. Elle avait demandé au vendeur qui avait répondu :
- Ces boots se sont vendues comme des petits pains. Quel succès ! Non, nous n’en recevrons plus.
Et là, c’était devenu une obsession. Pas parce que d’autres personnes voulaient aussi ces boots, simplement parce qu’elle ne pouvait pas les avoir. Non, ce n’était pas exactement ça non plus. Il fallait tout de même reconnaître qu’elles étaient très belles. Elle avait sillonné le Web pour les retrouver. Cherché sur le site du fabricant, cherché sur eBay. Elle aurait payé jusqu’à trois cents dollars pour avoir ces chaussures qui en valaient deux cents. Rien à faire.
- Les fameuses boots mirage, avait plaisanté Carmen alors que Lena les lui décrivait, extatique.
Quel rapport le désir, ce sentiment pervers et vain, pouvait-il entretenir avec l’amour? Ce n’était pas la même chose (tout du moins, elle l’espérait). Mais ces deux sentiments n’étaient pas non plus complètement distincts. Ils étaient liés, forcément. Parents ou époux?
Et Kostos? Elle le désirait, c’était sûr. Mais encore? Aurait-elle persisté à l’aimer s’il avait toujours été disponible? Oui. La réponse s’était imposée à elle avant même qu’elle ait fini de se poser la question. Oui, il avait été un temps où il l’aimait et elle l’aimait, et ils pensaient passer leur vie ensemble. Et ce temps-là l’avait marquée à jamais.
Aurait-elle pu se détacher de Kostos s’il ne lui avait pas été arraché de force ? Si elle avait simplement découvert, au fil des mois ou des années, qu’il ronflait, qu’il avait des boutons dans le dos ou les ongles incarnés et de fait les pieds puants?
Elle s’interrompit. Une minute. Elle ordonna à son esprit de reformuler la question. Aurait-elle pu l’oublier plus facilement s’il ne lui avait pas été arraché? Elle en avait fait le deuil, désormais. Oui, elle pensait parfois encore à lui, mais plus autant. Non, elle n’était jamais ressortie avec quelqu’un d’autre, mais...
Lena passa le restant du cours à jeter des regards obliques à cette main à droite de la toile et à cette touffe de cheveux qui la surmontait. Il était gaucher, nota-t-elle. Kostos était gaucher.
Il ne s’arrêtait même pas pendant les pauses, si bien qu’elle ne pouvait que l’entrapercevoir.
À la fin de la séance, Lena rangea lentement ses affaires. Elle s’attarda un peu, en faisant semblant de réfléchir (d’ailleurs, elle était réellement en train de réfléchir, non?). Puis elle quitta la salle à regret.
Et pour tout avouer, elle traîna dans le hall pendant quatorze minutes, jusqu’à ce qu’il se décide enfin à sortir de la salle et qu’elle puisse le voir.
Elle le connaissait. Non, elle ne le connaissait pas vraiment, mais elle en avait entendu parler. Il n’était pas en première année. Il devait avoir un ou deux ans de plus qu’elle. Elle avait déjà dû le croiser.
Physiquement, ce n’était pas le genre de personne qu’on oubliait. Il était grand avec une énorme masse de cheveux, la peau mate et dorée, et des taches de rousseur qui inspiraient la sympathie.
Il s’appelait Léo. Elle le savait parce qu’il était connu dans l’école. Connu pour son talent en dessin. Et cela, plus que toute autre chose, attisait le désir de Lena Kaligaris, vierge grecque.
Dans son petit cercle d’amis et de connaissances, ici, à Rhode Island, tous des mordus d’art, on murmurait avec ferveur qu’Untel ou que Trucmuche en avait ou n’en avait pas. Du talent, s’entend. Et le propriétaire de la main et des cheveux était l’un des rares élèves, presque une légende, à en avoir.
Elle le regarda avec un drôle de frémissement au creux du ventre et attendit qu’il la remarque. Elle s’était rarement retrouvée dans ce genre de situation. Elle avait envie qu’il pose sur elle un regard spécial. Peu importe qu’il ait une petite amie ou qu’il ne s’intéresse pas aux filles. Elle voulait que son regard s’attarde sur elle, admiratif, pour qu’il cesse d’être mystérieux et devienne comme tous les autres. (C’était bien ce qu’elle souhaitait, n’est-ce pas ?) Ce fameux regard qui lui confirmait le pouvoir particulier qu’elle exerçait sur les gens, sans le vouloir, la plupart du temps.
C’était ce qui lui donnait sa liberté. C’était ce qui lui donnait confiance en elle.
Mais il ne posa pas sur elle ce fameux regard. Il ne la regarda même pas. Les yeux rivés devant lui, il passa son chemin, lui rappelant pour la deuxième fois de la journée les boots marron à semelles compensées.
- J’ai été pris.
Brian lui annonça la nouvelle entre le porc au caramel et les biscuits surprises.
- Pardon ? demanda Tibby, qui n’était pas sûre d’avoir compris.
- J’ai été pris.
- C’est vrai?
Un peu gêné, il cassa son biscuit surprise en quatre, puis en huit, jusqu’à le réduire en miettes.
- C’est génial ! Je savais que tu en étais capable. C’était impossible qu’ils te refusent.
Depuis que Brian avait émis l’idée de transférer son dossier de l’université du Maryland à celle de New York, il avait obtenu des notes irréprochables.
- J’ai envie de pouvoir dormir avec toi toutes les nuits, lui avait-il dit en décembre. C’est tout ce que je veux.
Elle savait qu’il serait pris. Elle savait qu’il ferait en sorte de réussir. Il était comme ça.
- Tu as quoi comme message? demanda-t-il en désignant le petit mot que contenait le biscuit surprise.
- «Méfiez-vous de la domination de l’esprit», lut-elle,
Elle mordit dans son biscuit.
- Mes numéros porte-bonheur sont le 4 et le 297. Et toi ?
- «Vous êtes sexy», annonça-t-il.
- Non ? Ce n’est pas ce qui est écrit. Montre-moi.
Avec un sourire suggestif, il lui tendit le papier.
C’était pourtant vrai. Quelle injustice !
- Et pour l’argent ? demanda-t-elle en trempant son biscuit menteur dans la sauce.
- Eh bien...
- C’est galère?
Elle sentit les nouilles au sésame remonter dans son œsophage.
- J’ai obtenu six mille.
- Oh...
Elle avala sa salive.
-... dollars?
- Dollars.
Elle essaya de réfléchir. Le serveur déposa la note sur leur table sans même s’arrêter.
- Sur vingt-deux mille.
- Oh...
- Sans compter le logement et les repas.
- Oh, fit-elle encore en agitant ses baguettes. Et comment se fait-il que tu n’aies pas eu davantage ?
- Mon beau-père a plus d’argent que tu ne crois.
- Mais il ne veut pas te donner un cent, explosa Tibby.
Dans son monde à elle, les parents finançaient les études ou, s’ils n’en avaient pas les moyens, ils aidaient leurs enfants à obtenir un prêt pour couvrir la différence.
Brian n’avait pourtant pas l’air révolté. Même pas en colère. Ce que Tibby considérait comme un droit, il ne l’envisageait même pas,
- Je sais, oui. Mais c’est comme ça.
- Ce n’est pas juste qu’ils prennent en compte ses revenus. Tu ne peux pas leur expliquer qu’il refuse de payer quoi que ce soit ?
Brian haussa les épaules.
- J’ai mon épargne.
- Tu as combien?
- Cent soixante-dix-neuf.
Il prit l’addition. Elle la lui arracha.
- Je m’en occupe.
- Non, j’y tiens.
- Tu dois faire des économies.
- Je sais, mais je peux et faire des économies et t’inviter à dîner.
- Et prendre le car pour venir me voir pratiquement tous les week-ends et m’offrir des CD ?
Elle ne voulait pas avoir l’air de lui faire des reproches, mais...
Il sortit son portefeuille. Elle aperçut l’emballage du préservatif qu’il avait glissé là trois ou quatre mois plus tôt.
- Pour le jour où on sera prêts, avait-il dit lorsqu’elle l’avait remarqué, la première fois.
Il sortit un billet de vingt - froissé et délavé comme si c’était le dernier survivant de son espèce.
- Allez, s’il te plaît, laisse-moi payer, supplia-t-elle.
Elle avait sorti son porte-monnaie, elle aussi.
- La prochaine fois, fit-il en se levant, la laissant son porte-monnaie mutile à la main.
Il disait toujours ça. À peine étaient-ils sortis qu’il avait déjà passé le bras autour d’elle. C’était fou qu’ils arrivent à marcher aussi collés-serrés.
Dans l’ascenseur, ils profitèrent d’être seuls. Dès qu’ils furent dans sa chambre, Brian alla ouvrir son sac et en tira une bouteille de vin.
- Pour fêter ça.
- Où tu l’as dénichée ? s’étonna-t-elle.
Brian n’était pas du genre à sortir une fausse carte d’identité pour tricher sur son âge.
Il prit un air mystérieux.
- Je l’ai trouvée par hasard...
- Chez toi?
Il rit.
- Je passais par là. Elle est vieille de toute façon.
Elle regarda l’étiquette. Une bouteille de vin rouge de 1997.
- Très drôle.
- Attends.
Il fila dans le couloir pour revenir avec deux gobelets en plastique et un tire-bouchon qu’il avait pris dans la kitchenette commune. Il ne savait pas se servir de cet ustensile et elle non plus. Finalement, au prix d’une bonne crise de fou rire, il réussit à déboucher la bouteille. Il versa le vin dans les deux gobelets, puis mit un CD de Beethoven, le cinquième concerto pour piano, qu’elle adorait, il le savait.
- C’est un peu fort, remarqua-t-elle.
- Il n’y a personne.
- Mmm, c’est vrai.
Ils s’assirent en tailleur par terre, face à face. Quand ils trinquèrent, le plastique souple s’enfonça sans faire de bruit.
- À nous deux, dit-elle.
Ravi, il rougit. Soudain, elle se sentait gênée. Elle aurait voulu trouver un truc ironique à dire, mais rien ne lui vint. Elle but une longue gorgée de vin.
- Il est bon ? demanda-t-il en la tirant par les pieds pour la rapprocher de lui.
- Je ne sais pas. Tu le trouves bon, toi ?
Il goûta à nouveau.
- Un peu vieux, non ?
- Je crois que ça me plaît, dit-elle.
Tout lui plaisait en cet instant, et le vin faisait partie du tableau.
- Il en reste.
- Prends-en aussi.
Elle se retourna et s’adossa contre lui, le vin lui réchauffant le sang et la musique les oreilles. Il devait y avoir des gens qui, de toute leur vie, ne connaissaient jamais un tel bonheur. Cette pensée était la seule note triste qui assombrissait sa joie.
Il siffla pour accompagner le violon pendant quelques mesures.
- C’est la plus belle soirée de ma vie, constata-t-il à voix basse, lisant dans ses pensées, comme bien souvent.
- Avec la soirée à la piscine.
- Oui, concéda-t-il, mais je ne te connaissais pas aussi bien à l’époque. Je croyais te connaître, mais je sais que je me trompais. Et tu imagines, l’année prochaine ou celle d’après ?
Brian ne craignait pas d’envisager l’avenir, sûr qu’elle en ferait partie. Il parlait de quand ils auraient trente ans aussi facilement que de quand ils en auraient vingt. Il parlait bébé et se demandait si leur enfant hériterait du long doigt de pied du milieu de Tibby. Il rêvait de tout ça. Et il n’avait pas peur de le dire.
Il aimait lui parler de ses rêves et il rêvait toujours en «nous».
- Qui ça «nous»? lui avait-elle demandé la première fois qu’il lui avait exposé un de ses longs scénarios compliqués.
Il l’avait regardée, perplexe, comme s’il ne comprenait pas pourquoi elle plaisantait avec ça.
- Eh bien, toi et moi.
Ça ne pouvait pourtant pas continuer à être aussi bien, de mieux en mieux, même, se disait Tibby. Impossible. C’était contre les lois de la physique. Sans rire, ces choses-là étaient régies par une sorte de loi. L’arithmétique du bonheur. La quantité de bonheur existant dans l’univers était constante et, pour en avoir davantage, il fallait bien le prendre quelque part. Et ils en consommaient plus que leur dû.
Il lui versa un autre verre de vin. Elle se rendait plus ou moins compte qu’elle avait trop bu. Elle le sentait sans en prendre vraiment conscience.
La bouteille et les gobelets en plastique furent écartés et ils se retrouvèrent à s’embrasser passionnément sur le sol en lino.
Vint le second mouvement du concerto, trop beau, trop fort pour quoi que ce soit.
- Si on allait sur le lit ? proposa-t-elle d’une petite voix.
En principe, c’était elle qui gardait le contrôle dans ce genre de situation. C’était elle qui avait décidé qu’ils n’étaient pas encore prêts à faire l’amour. Ils étaient tous les deux vierges. Il était plus que prêt, mais elle n’était pas encore sûre. Et il avait beau supplier, il ne la forçait pas. C’était un gentleman.
Mais là, elle était collée contre lui, ses hanches n’avaient pas besoin de son cerveau pour savoir quoi faire. Elle se retrouva sans chemise sans s’en être vraiment aperçue. Depuis quelque temps, Brian avait compris comment détacher son soutien-gorge.
Elle réussit à lui ôter son T-shirt. Il n’y avait rien de meilleur que de sentir sa peau nue contre la sienne, et ses quelques poils tout doux au milieu de son torse.
« Mais qui gardait la maison, alors ? » se demanda-t-elle dans un brouillard.
Ils fonçaient droit devant, reproduisant les mêmes gestes que d’habitude, simplement plus vite, plus fort. Son corps ne la consultait plus du tout. Elle le voulait tout contre elle, elle le voulait en elle.
Elle voulait arrêter. Dire : «Attends, une minute.» Réfléchir un peu, au moins. Se reprendre. Mais elle ne pouvait pas lui dire d’arrêter. Elle n’avait pas envie. Elle voulait le sentir en elle. Il était tellement près maintenant.
- Est-ce qu’on a...?
- Oui, répondit-il sans même qu’elle ait besoin de formuler sa pensée.
Il farfouilla moins d’une seconde avant de dénicher le fameux préservatif.
- Tu veux...?
- Je ne sais pas...
Elle l’aimait. Elle le savait.
Et l’espace d’un instant, simple et pur, ils se retrouvèrent plus proches l’un de l’autre qu’ils ne l’avaient jamais été.

La première se déroula dans un brouillard. Carmen, toute vêtue de noir, s’épuisa à changer les décors et à gérer les accessoires. Elle restait très concentrée, il n’y avait pas de place pour la moindre erreur. Même si elle se débrouillait bien, c’était le genre de boulot où on ne se faisait remarquer qu’en cas de problème.
Carmen applaudit toute la troupe, et Julia, qui jouait Annie Sullivan, encore plus fort que tous les autres. Elle s’assura qu’un bouquet de roses lui soit porté sur scène. Elle était fière de son amie. Mais avec Julia, même la fierté se tintait de gratitude.
Carmen avait fait des efforts. Elle avait appris des tas de choses. Elle avait trouvé la réponse à ses propres questions sans demander à personne. D’accord, elle était toujours parfaitement invisible, mais on ne pouvait nier qu’elle faisait preuve de beaucoup de compétence.
Après la pièce, elle offrit à Julia un bracelet en argent. Son amie la remercia en lui apportant une assiette de brownies dans sa chambre, plus tard dans la soirée.
- Au fait, tu sais dans quelle chambre tu seras au festival de théâtre ? lui demanda-t-elle, le papier à la main.
- Je crois, oui.
Carmen prit sur son bureau la lettre qui était arrivée le matin même du Vermont.
- Bâtiment Forte, chambre 3H, annonça Julia. On est ensemble ?
- 3H, ouais !
- Ah, tant mieux!
Quel soulagement ! Une fois de plus, Carmen se dit qu’elle avait de la chance. Heureusement que Julia voulait être avec elle. Elle avait craint un instant qu’elle ne préfère partager sa chambre avec une nouvelle.
- Mon frère a promis de m’y conduire en voiture. Il va voir une copine à Dartmouth, il paraît que ce n’est pas trop loin. Tu veux venir avec nous? Tu sais déjà comment tu vas y aller ?
Le frère de Julia, Thomas, était l’un des canons de la fac. En sa présence, Carmen, tout émue, ne pouvait articuler le moindre mot. Non contente d’être invisible, elle devenait muette.
- Ce serait génial, je n’avais encore rien prévu.
- Parfait, conclut Julia, l’air sincèrement ravi. On va se chercher un café ?
- OK.
Et Carmen suivit l’exubérante Julia dans les couloirs, impressionnée par sa jupe mexicaine, le rouge profond de son débardeur, sa minceur et son assurance - il n’y avait qu’elle pour oser porter une casquette en tweed comme ça. Une fois de plus, Carmen se sentit submergée de gratitude d’avoir quelqu’un avec qui faire des choses. Et pas n’importe qui : la fille la plus époustouflante de la fac.
Carmen fit la queue au foyer des étudiants pour commander deux cafés au lait. Lorsqu’elle revint à la table, elle trouva Julia entourée d’une petite cour de garçons de deuxième année. Elle se glissa sans bruit sur la chaise à côté d’elle. Elle rit à toutes ses blagues, admirant son aisance.
Pour la centième fois, Carmen se demanda ce qu’elle pouvait bien lui trouver. Cette amitié était on ne peut plus précieuse pour elle, mais qu’en tirait Julia? Il y avait sur le campus des filles glamour dans son genre, qui lui auraient bien mieux convenu comme amies, et pourtant elle continuait à traîner avec la terne, la mutique, l’invisible Carmen.
Elle fixa le fond de son gobelet de café tandis que Julia racontait avec force détails comiques le moment où la chaîne stéréo s’était détraquée au beau milieu de l’acte II. Carmen s’en voulait de faire une si piètre amie. Elle aurait dû essayer de trouver des trucs à dire au lieu de rester assise là comme une idiote. Mais non, elle n’avait rien à offrir.
Julia ne méritait pas de traîner une nullasse noyée dans un sweat trop grand. Carmen se promit de se reprendre en main, pour faire honneur à Julia.
Allongée tout contre Brian, la joue collée à son torse moite, Tibby sentit de petites larmes chaudes jaillir du coin de ses yeux, couler le long de son nez, tomber goutte à goutte sur sa cage thoracique. Jamais larmes ne lui avaient paru plus sincères et plus mystérieuses. Lorsqu’elle caressa le visage de Brian, elle sentit que ses cils aussi étaient mouillés.
Elle aurait voulu rester éternellement comme ça. Elle avait envie de se fondre dans son corps et d’y passer sa vie. Le seul problème, c’est qu’elle avait envie de faire pipi.
À un moment, elle roula sur le dos et il s’assit. Elle porta les mains à ses joues en feu.
- Qu’est-ce...?
Il émit un bruit bizarre.
Elle s’assit également, surprise.
- Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-elle d’une voix assoupie.
- Je... le... je ne sais pas...
- Brian?
- Le préservatif... je crois que... il n’était pas...
- Il n’était pas quoi ?
Elle n’osait même pas regarder.
- Pas... bien mis.
- Qu’est-ce que tu racontes ?
Elle n’avait pas élevé la voix, mais tous ses muscles s’étaient raidis.
- Bon sang, Tib ! Je ne sais pas. Il s’est peut-être déchiré. Je crois qu’il s’est déchiré.
- Ah bon?
Il examinait l’objet, les cheveux dans les yeux. Il tendit la main vers elle, mais elle s’était déjà mise debout, entraînant la couette avec elle.
- Tu es sûr?
Maintenant, elle haussait le ton. Les graines de l’inquiétude avaient germé et poussaient à vue d’œil, comme une plante verte dans un documentaire télévisé, image par image.
- Ça va aller. Je vais... Je vais...
- Tu es sûr qu’il s’est rompu ?
Elle tenait la couette plaquée contre elle des deux mains. Oh, comme elle haïssait ce préservatif incompétent qui était resté dans son portefeuille pendant des mois !
Brian était assis sur le lit comme Le Penseur de Rodin.
- Oui, je crois bien. Je ne sais pas quand ça s’est passé.
Elle pouvait tomber enceinte. Si ça se trouve, elle était en train de tomber enceinte en ce moment même. Et les maladies sexuellement transmissibles? L’herpès ? Et le sida, bon Dieu ?
Non, il était vierge. Enfin, c’est ce qu’il lui avait dit. Pourvu que ce soit vrai. C’était vrai, hein?
- Ça s’est passé pendant qu’on faisait l’amour, répliqua-t-elle sèchement.
Il leva les yeux vers elle, sans comprendre pourquoi elle avait pris ce ton-là.
Elle risquait de tomber enceinte ! Oui, c’était possible. C’était exactement comme ça que ce genre de chose arrivait ! Il fallait qu’elle réfléchisse. Quand avait-elle eu ses règles? Ces choses-là arrivaient à de pauvres filles, des filles qui n’étaient pas aussi prudentes et avisées que Tibby.
Que devait-elle faire ? Qu’est-ce qui lui arrivait ? Depuis des années, malgré tout ce qui se passait dans sa vie, elle avait toujours trouvé une sorte de réconfort à se dire que, au moins, elle était toujours vierge. Au moins, elle n’avait pas à se soucier de ce genre de chose. Elle n’avait pas encore sauté le pas.
Désormais, elle n’était plus vierge. Comment avait-elle pu oublier, ne serait-ce qu’un instant, tout ce que cela impliquait ?
Elle regarda Brian, qui se tenait aussi loin d’elle qu’il le pouvait dans cette chambre minuscule. Elle aurait dû s’inquiéter de tout ça à voix haute, avec lui, pas seule. Mais elle n’y arrivait pas.
Elle aurait aimé pouvoir se rhabiller hors de sa vue. Elle se détourna.
- Je suis désolé, Tibby. Désolé que ce soit arrivé. Je ne savais pas que...
- Mais tu n’as rien fait, murmura-t-elle dans un souffle, en s’adressant au mur.
- J’aimerais tellement...
Bridget avait l’estomac qui gargouillait depuis qu’elle avait ouvert un œil ce matin, mais lorsque son père déposa une assiette d’œufs brouillés pour elle sur la table, elle se mit à arpenter la cuisine au lieu de s’asseoir devant.
- Papa, pourquoi as-tu laissé Perry arrêter la fac?
Son père était vêtu d’un pantalon informe et d’une veste en tweed, tenue qu’il avait toujours arborée au travail, aussi loin que remontaient ses souvenirs. Il était prof d’histoire et assistant du directeur dans un lycée privé,et d’une incompétence dont seul un aussi vieux membre de l’enseignement secondaire pouvait faire preuve. Son métier consistait à ignorer les jeunes dont il s’occupait. Il avait donc de l’entraînement et mettait ce talent à profit avec ses propres enfants.
- Il n’a pas arrêté. Il fait une pause.
- C’est ce qu’il t’a dit ?
Son père se mura dans le silence. Il n’aimait pas qu’on exige quoi que ce soit de lui. Il résistait de manière passive.
- Tu devrais prendre ton petit déjeuner si tu veux que je te dépose en partant au lycée, dit-il d’une voix posée.
Il lui proposait toujours de la déposer ici ou là.
- Pourquoi veut-il faire une pause ? Tu lui as demandé ? Suivre trois cours à l’université locale n’est pas particulièrement épuisant.
Il se versa son café.
- Tout le monde ne fait pas partie de l’élite, Bridget.
Elle lui jeta un regard noir. Il essayait de la forcer à battre en retraite. Il savait bien que sa fille n’était pas une tête ni une snob, et qu’elle était un peu gênée d’être à l’université Brown. Il pensait sûrement que ça allait lui clouer le bec, mais il n’en était pas question.
- Alors il reprendra ses études à la rentrée ? insista-t-elle.
Son père posa les couverts sur la table et s’assit pour manger.
- J’espère.
Elle essaya de capter son regard.
- C’est vraiment ce que tu espères ?
Il rajouta du sel sur ses œufs brouillés, puis attendit qu’elle s’asseye. Elle n’en avait aucune envie. Face à lui, elle pratiquait également la résistance passive. C’était l’une des rares choses qu’ils avaient en commun.
C’était un geste, de lui avoir préparé ces œufs. Il l’avait fait pour elle. Et pourtant leur simple vue lui retournait l’estomac. Pourquoi ne pouvait-elle répondre à ses rares tentatives de communication ?
Il refusait de lui donner ce qu’elle voulait. Elle refusait de prendre ce qu’il lui donnait.
Elle s’assit. Prit sa fourchette. Il se mit à manger.
- Je me fais du souci pour lui, avoua-t-elle.
Il hocha vaguement la tête. Ses yeux s’attardèrent sur le journal posé à côté de son assiette. La plupart du temps, il petit-déjeunait en compagnie du Washington Post et il n’avait pas l’air d’apprécier ce changement dans ses habitudes.
- On dirait... qu’il dépérit, cloîtré dans sa chambre.
Son père la regarda enfin.
- Il ne s’intéresse pas aux mêmes choses que toi, ça ne veut pas dire qu’il ne s’intéresse à rien. Pourquoi tu ne manges pas ?
Elle n’avait pas envie de manger. Elle n’avait pas envie de lui obéir. Elle avait l’impression que, si elle mangeait, ce serait une marque d’assentiment, comme si elle acceptait cette vie souterraine qu’ils menaient, et elle refusait de le faire.
- Il voit des gens ? Il sort, parfois ? Est-ce qu’il s’intéresse à autre chose qu’à ce fichu ordinateur auquel il est rivé nuit et jour ?
- Ne dramatise pas, Bridget. Il va bien.
Brusquement, elle laissa éclater sa fureur. Elle se leva, lâchant sa fourchette qui tomba bruyamment sur le sol.
- Il va bien ? hurla-t-elle. Aussi bien que maman, c’est ça ?
Il s’arrêta de mâcher. Reposa sa fourchette. Il ne la regardait pas, son regard passait à travers elle, se perdait dans le vide.
- Bridget, fit-il dans un grognement sourd.
- Regarde un peu autour de toi ! Tu ne vois pas qu’il ne va pas bien?
- Bridget, répéta-t-il.
Plus il répétait son nom, moins elle avait l’impression qu’il se trouvait dans la pièce avec elle.
- Tu ne vois pas que ce n’est pas une vie !
Elle sentait les larmes lui serrer la gorge, lui brûler les yeux, mais elle ne s'autorisait pas à pleurer. Elle ne se sentait pas assez en confiance pour pleurer on sa présence, et depuis bien longtemps. «On ne peut pas vivre aussi seul.» Il secoua la tête. Bien sûr qu’il ne voyait rien. Parce qu’il vivait de la même manière, exactement.
Bridget. Tu mènes l’existence que tu as choisie. Laisse ton frère faire de même.
« Et moi aussi, laisse-moi vivre», aurait-il aussi bien pu ajouter.
Elle refusait de s’asseoir. Elle refusait de manger ses œufs. Mais elle allait mener l’existence qu’elle avait choisie. Ça, elle pouvait le faire pour lui.
Elle prit son sac marin, son sac à dos, et sortit de la cuisine, de la maison. Partir, voilà ce qu’elle choisit.
- Alors, quand il a appelé, je lui ai dit que je ne pouvais pas lui parler, expliqua Julia, assise en tailleur sur le lit de Carmen dans leur petite chambre du Vermont. Je m’en voulais et tout, mais je ne sais pas comment lui dire que je veux faire une pause pour l’été.
C’était drôle. Le cadre avait beau changer - le campus d’une université des arts de la scène où se tenait un festival de théâtre -, la situation ne changeait pas : Julia assise sur un lit le soir en train de raconter à Carmen le dernier épisode de sa relation tumultueuse avec Noah Markham, élève brillant et néanmoins canon.
Carmen hocha la tête. Elle avait fini de ranger ses affaires, mais se mit à les replier.
- Tu comprends, si je rencontre quelqu’un ici? Tu as vu? Il n’y a que des beaux mecs. Dont la moitié sont sûrement homo, mais quand même.
Nouveau hochement de tête. Carmen n’avait pas encore vraiment vu quoi que ce soit.
- Dans ce genre d’endroit, tout peut arriver. On sait bien que les acteurs tombent tout le temps amoureux de leur partenaire.
Carmen lisait assez souvent la presse à scandale pour savoir que c’était vrai. En posant une bouteille de leur shampooing préféré sur la commode de Julia, elle vit le portrait noir et blanc de sa mère dans son cadre argenté. Il décorait sa chambre à la fac. C’était un cliché artistique pris par un photographe célèbre que Carmen avait prétendu connaître. La mère de Julia avait été mannequin, selon elle. Elle était belle, certes, mais Carmen avait aussi remarqué qu’elle n’appelait presque jamais sa fille.
Elle, elle n’exposait pas sa famille mais, à l’intérieur de son classeur, elle avait une petite photo de Ryan le jour de sa naissance. Elle avait aussi celle que les quatre filles avaient prise lors de leur dernier week-end ensemble sur la plage de Rehoboth. Durant l’hiver, elle l’avait déplacée à la fin de son classeur, parce que sa vue suscitait chez elle un bonheur mélancolique, le plus triste des bonheurs.
Julia regardait Carmen ranger la chambre.
- Au fait, tu as pensé au baume démêlant Teramax?
Carmen haussa les sourcils.
- Je ne crois pas. C’était sur la liste ?
Julia acquiesça.
- Je suis sûre de l’avoir noté.
Carmen passa en revue les sacs de la pharmacie, mais n’y trouva aucune bouteille de démêlant de quelque marque que ce soit.
- Ça a dû m’échapper.
Elle s’en voulait, alors qu’elle-même n’en utilisait pas.
- Ne t’en fais pas, la rassura Julia.
- J’en achèterai quand on ira en ville, promit-elle sur un ton d’excuse.
- Sincèrement, ce n’est pas grave.
Julia finit par s’endormir, mais Carmen resta éveillée dans son lit. Elle avait du mal à se rappeler où elle était.
Au bout d’un moment, elle se leva pour aller vérifier la liste de produits que Julia lui avait demandé d’acheter à la pharmacie. Le baume démêlant Teramax n’y figurait pas.
Elle sortit dans le couloir pour appeler Lena. Comme elle ne répondait pas, elle laissa un message. Tibby ne décrocha pas non plus et Bridget était déjà partie en Turquie.
Malgré l’heure tardive, elle téléphona à sa mère.
- Allô, nena. Tout va bien ? s’inquiéta-t-elle d’une voix ensommeillée.
- Oui, on vient de s’installer.
- Ça a l’air sympa?
- Oui, oui, répondit Carmen sans réfléchir. Comment va Ryan ?
Sa mère se mit à rire.
- Il a jeté ses chaussures par la fenêtre.
- Oh non ! Les neuves ?
- Mmm.
Carmen imagina son frère qui lâchait ses petites baskets dans le vide et sa mère qui filait pour essayer de les retrouver.
- Côté jardin ou côté rue ?
- Dans la rue, évidemment.
Carmen éclata de rire.
- Et sinon, quoi de neuf ? demanda-t-elle avec une note de mélancolie dans la voix.
- Nous avons vu les peintres aujourd’hui, annonça sa mère comme si elle avait rencontré le président.
- Ah oui?
- Ils vont commencer à enduire les murs. Pendant ce temps, on va choisir les teintes,
Carmen bâilla. Elle n’y connaissait pas grand-chose en enduits.
- OK, mamâ. Bon, dors bien.
- Toi aussi, nena. Je t’aime.
Carmen rentra dans la chambre sur la pointe des pieds et se faufila dans son lit en prenant garde à ne pas réveiller Julia, qui avait le sommeil léger.
Elle savait que sa mère l’aimait. Autrefois, cela lui apportait une certaine confiance en elle. Ce simple fait lui permettait de savoir qu’elle était quelqu’un.
Elle avait l’impression qu’elles ne faisaient qu’un, qu’elles vivaient la même vie. Désormais, elles menaient leurs vies chacune de leur côté. Elle ne pouvait plus se référer à Christina pour savoir qui elle était.
Cela ne voulait pas dire que sa mère ne l’aimait plus. Elle lui avait donné la vie, mais elle ne pouvait pas la vivre à sa place. Et, bizarrement, Carmen n’était pas certaine d’être capable de la vivre seule.
Elle glissa ses mains sous son oreiller. Elle avait beau entendre la respiration régulière de Julia à moins de un mètre, elle se sentait terriblement seule.
Lorsque Lena rentra dans sa chambre ce soir-là, elle rappela Carmen, en espérant qu’il n’était pas trop tard.
- J’ai une chose à te demander, mais promets de ne pas me mitrailler de questions, lui annonça-t-elle une fois que Carmen eut réussi à localiser le téléphone du couloir.
- Comme si c’était mon genre ! répliqua-t-elle, trop intriguée pour s’indigner bien longtemps.
- À ton avis, j’ai fait mon deuil de Kostos ?
- Tu as rencontré quelqu’un d’autre ?
Lena fixa le plafond.
- Non.
- Tu as posé les yeux sur quelqu’un d’autre ?
Lena se sentit rougir, soulagée que son amie ne puisse pas la voir. Carmen avait toujours fait preuve soit d’une clairvoyance proche de la divination, soit de l’aveuglement le plus total, mais rarement des deux en même temps.
- Pourquoi tu me demandes ça ?
- Parce que je pense que tu auras officiellement fait le deuil de Kostos quand tu penseras à un autre garçon - ou même que tu te contenteras de le regarder.
- Ce n’est pas un peu simpliste ?
- Pas du tout, se récria Carmen.
Lena rit.
- Un jour, tu tomberas amoureuse et tu l’oublieras. C’est forcé, ça arrivera tôt ou tard. Et j’espère que ce sera tôt.
Lena croisa les jambes sur son lit. Pouvait-elle oublier Kostos ? Était-ce son but ultime? Jusque-là, elle s’était efforcée d’en «faire son deuil» - si tant est que cela veuille dire quelque chose - et elle se félicitait d’avoir fait des progrès en ce sens. Mais elle avait du mal à envisager de l’oublier. Elle n’était pas du genre à oublier.
- Je ne crois pas que ce soit possible.
- Mais si. Ça arrivera. Et tu sais ce que je pense à propos de Kostos ?
Lena soupira. Elle avait déjà du mal à prononcer ce prénom, mais elle supportait encore moins de l’entendre dans la bouche des autres.
- Non, génial génie, qu’est-ce que tu penses ?
- J’ai le pressentiment que, dès que tu auras oublié Kostos, tu vas le revoir. Lena sentit que ça travaillait dans son ventre. Entre la lourdeur qui annonce la nausée et le frémissement d’excitation.
- Ah oui, tu crois ça.
Elle avait voulu prendre un ton légèrement ironique, mais il était carrément sinistre.
- Oui, franchement, j’en suis persuadée, déclara solennellement Carmen. Lena raccrocha avec l’impression, peut-être même l’espoir, que Carmen était dans sa phase d’aveuglement total.

Elle avait eu ses règles sur la route entre la fac et Bethesda, non? Tibby essayait de se rappeler les réjouissances qui accompagnaient d’habitude cet événement - sous-vêtements tachés, oubli des tampons, nécessité de s’arrêter d’urgence dans une station-service.
- Tibby Rollins?
Elle était revenue en voiture avec Bee. Son amie avait emprunté la voiture de sa voisine de chambre à Providence et était passée la prendre à New York. Elles s’étaient arrêtées au moins deux fois. Une fois pour faire le plein d’essence et l’autre pour des raisons plus personnelles. Mais impossible de se rappeler si c’était pour acheter d’urgence des serviettes ou un paquet de cookies double chocolat. Elle n’en avait aucun souvenir. Elle était vierge à l’époque, et les vierges ont la chance inouïe de pouvoir rester dans l’ignorance la plus complète du calendrier de leurs règles.
- Tibby Rollins?
Elle se retourna, agacée, vers son responsable. Charlie s’entêtait à l’appeler par ses nom et prénom comme s’il y avait trois autres Tibby dans le magasin.
- Charlie Spondini? répliqua-t-elle.
Il fronça les sourcils.
- La boîte de retour est tellement pleine qu’on ne peut plus glisser une feuille de papier dans la fente. Ça te dérangerait... ?
- Ça me dérange, oui. Il s’agit effectivement d’un manque d’égards flagrant envers notre clientèle, susceptible de générer une perte de bénéfices.
Parfois, elle arrivait à le faire rire, mais aujourd’hui elle se rendait bien compte qu’elle n’était pas drôle, juste insolente. Elle avait presque envie de se faire virer.
- Tibby Rollins...
Il avait l’air plus las que furieux.
- Bon, d’accord.
Elle se dirigea vers l’immense boîte en carton, sous le comptoir, et entreprit de la vider.
Avec Bee, elles étaient rentrées le 4 juin. Si elle avait eu ses règles à ce moment-là, ça voulait dire que... Ça voulait dire quoi? Était-elle censée savoir quand elle ovulait? Tout ça la répugnait. Elle avait suivi malgré elle les traitements de stimulation ovarienne de sa mère, les courbes de température, les tests. Elle n’avait pas envie de pénétrer dans ce monde.
- Pardon?
Bile leva les yeux. C’était un client. Il avait des lunettes teintées et ses cheveux gris peignés sur le côté camouflaient mal sa calvitie.
- Vous avez Strip-tease ?
- Hein?
Elle lui jeta un regard de dégoût.
- Strip-tease ?
Beurk.
- Si on l’a, c’est au rayon comédie dramatique.
- Merci, fit-il avant de s’éloigner.
- C’est un navet, précisa-t-elle à l’attention de son dos.
Dans sa chambre, le voyant «message» de son téléphone clignotait. D’habitude, les messages romantiques de Brian lui remontaient le moral. Ce soir, elle dut se forcer à écouter.
- Tib, je me suis renseigné. Tu peux prendre un médicament...
Il paraissait tendu, préoccupé.
-...Je pense qu’il n’est pas trop tard. Je viendrai ce soir si tu veux que je t’accompagne. J’ai l’adresse du planning familial. Ce n’est pas loin, sur Bleecker Street. Je peux...
Elle appuya sur le bouton « effacer», plongeant la chambre dans le silence. Elle ne voulait pas connaître l’adresse du planning familial. Elle ne voulait pas mener ce genre de vie. Elle ne voulait pas être examinée par un gynécologue et prendre des médicaments. Elle voulait que son expérience sexuelle reste sans ordonnance.
Pourquoi avait-elle fait ça ? Pourquoi avait-elle laissé Brian la convaincre ? «Il n’a pas vraiment eu à te convaincre», fit la voix de Méta-Tibby. En fait, cela s’était passé sans paroles.
Mais c’était lui qui en avait tellement envie. C’était lui qui attendait et suppliait depuis des mois. C’était lui qui avait ce maudit préservatif dans son portefeuille. C’était lui qui pensait que ça allait encore les rapprocher.
Toute sa colère et sa rancœur étaient focalisées sur cette saleté de préservatif et sur Brian qui l’avait gardé sur lui pendant si longtemps et avec tant d’espoir.
Elle alluma sa petite télé. C’était les infos sur la sept. Tibby regardait toujours cette chaîne parce qu’elle aimait bien la présentatrice. Elle était plus âgée que les autres, presque la soixantaine, et elle s’appelait Maria Blanquette.
Elle avait la peau mate, des traits intelligents mais pas parfaits et, contrairement à la plupart des nouvelles animatrices camouflées sous leur épais masque de maquillage, Maria avait l’air d’une vraie femme. Elle présentait la chronique «Vu à Manhattan» dans laquelle elle était censée faire la promo de tous les événements people de New York. Mais au lieu de se prosterner aux pieds des stars comme la plupart des autres présentateurs, Maria riait. Et elle avait un rire très inhabituel pour la télévision. Un rire incontrôlable, bruyant, pas policé du tout. Tibby ingurgitait des heures de journal télévisé pour ne pas manquer ces moments-là.
Elle attendit, pleine d’espoir. Mais aujourd’hui, Maria n’avait pas envie de rire. Sans doute ses producteurs lui avaient-ils conseillé de la fermer.
En principe, Bridget aimait manger dans l’avion. Elle était l’une des rares à apprécier les plateaux-repas.
Si on engloutissait tout tant que c’était chaud, ça passait. Mais, constata-t-elle, si on hésitait et qu’on laissait refroidir, ce n’était plus tellement appétissant. Comme beaucoup de choses dans la vie.
Ce soir, elle laissa son plateau sur la tablette, intact. Eric était à Bahia. Elle l’imagina en train de plonger dans la mer de Cortez. C’était presque l’heure du dîner là-bas et il piquait toujours une tête avant de manger. Et elle était là-haut, à des kilomètres au-dessus de l’Atlantique. Ils étaient tous deux suspendus au-dessus de l’eau, leurs pieds ne touchaient pas terre.
- Eric fait comme si je n’avais besoin de rien, s’était-elle plainte à Tibby quelques jours auparavant, au téléphone.
- Peut-être que tu te comportes comme si tu n’avais besoin de rien, avait-elle répondu.
Elle avait dit ça sans agressivité aucune, mais l’idée avait tout de même fait son chemin dans l’esprit de Bridget.
Elle eut un frisson d’angoisse d’être aussi loin du sol et de filer à si grande vitesse loin d’Eric, de chez elle et de toutes les choses dont elle avait besoin.
Il faisait noir dans la cabine. Noir dehors, derrière le hublot. Elle n’était pas complètement seule. Disséminées dans l’avion, il y avait plein d’autres personnes qui se rendaient au chantier. Les gens avec qui elle allait passer l’été. Pour l’instant, elle ne les connaissait pas mais, théoriquement, c’étaient des amis en puissance. Dommage qu’elle ne soit pas plus douée pour la théorisation !
Elle préférait les vols courts, où on ne changeait pas de jour. Elle était un peu désorientée d’aller dans le sens contraire du soleil.
Elle posa ses mains froides sur le jean, sentant sous ses doigts le contact rassurant des points de broderie maladroits et de l’encre gonflante de Carmen.
De quoi avait-elle réellement besoin? Elle avait besoin de ses amies, mais elle avait le jean magique. C’était un peu comme si elle emmenait ses amies avec elle. Le jean leur permettait de rester en contact quoi qu’il arrive.
Elle avait Greta. Elle était chez elle, à Burgess, comme toujours. En calculant quelle heure il était là-bas, Bridget pouvait facilement deviner ce qu’elle était en train de faire. Le mardi soir à sept heures, elle jouait au loto. Le mercredi matin, elle allait faire des courses. Bridget pouvait foncer aussi loin, aussi vite qu’elle le voulait, Greta ne bougeait pas.
Et puis il y avait Eric. À un moment donné dans sa vie, elle avait eu besoin de lui et il avait été là. Il avait su exactement quoi faire. Elle ne l’oublierait jamais.
Et la maison. D’un point de vue technique, cela désignait une vieille maison en bois abritant son père et son frère. Elle avala sa salive. Tendit son plateau à une hôtesse qui passait. Avaient-ils besoin d’elle ? Avait-elle besoin d’eux ?
Elle ne se posait pas les bonnes questions. C’était «s/o». En voyant trois « s/o » sur son premier bulletin de notes, elle avait d’abord cru qu’elle avait eu une mauvaise note dans ces matières. Mais son père avait ri en lui ébouriffant les cheveux.
- Ça veut dire « sans objet », tu n’as rien raté du tout, ma petite abeille.
Il avait su la rassurer à l’époque. Peut-être qu’elle y mettait un peu plus du sien, elle aussi.
Maintenant, à la maison, on ne pouvait plus parler en termes de besoins. Même si son père ou Perry avaient besoin d’elle, peu importait, parce qu’ils n’accepteraient pas son aide, de toute façon. Et si elle avait besoin d’eux... elle n’avait pas besoin d’eux. Ils n’avaient rien à offrir qu’elle puisse leur envier.
Elle allait dans le sens contraire du soleil, mais il serait là pour l’accueillir à l’atterrissage. Ils prenaient un chemin différent pour se rendre au même endroit, voilà tout.
Elle se détendit dans son fauteuil, arrachant son esprit au continent qu’elle laissait derrière elle pour le projeter vers celui qui l’attendait. Elle ne pouvait rien pour son père ou pour Perry. Rien du tout. Maintenant il fallait qu’elle aille de l’avant et qu’elle fasse sa vie comme elle l’entendait, du mieux possible. Plus besoin de regarder en arrière.
Elle ôta ses baskets et replia ses pieds sous ses fesses. Elle croisa les bras et glissa ses mains sous ses aisselles pour les mettre au chaud. Lorsqu’elle se réveillerait, elle serait en Turquie. Sur un autre continent, dans un autre monde.
Cette fois, elle sentit un frisson d’excitation, et non plus d’angoisse. Le genre qui vous donne faim et non mal au cœur. Qui vous fait regarder vers l’avant et non vers l’arrière.
D’une certaine façon, c’était le même frisson. Mais beaucoup plus agréable.
Carmen gribouillait sur les prospectus pendant que les aspirants théâtreux - qu’on appelait ici les «amateurs » - venus de tout le pays assistaient à la réunion de présentation dans le bâtiment principal. Julia était en train de se vernir les ongles de pieds, une activité assez débilitante, tout de même. Mais avec du vernis noir, activité digne d’une actrice, d’après Carmen.
Elle balaya du regard l’assemblée de garçons et de filles super lookés. Julia n’était pas la seule à avoir adopté le style vintage et eye-liner noir. C’était presque drôle : à la fac, Julia se détachait de la masse par sa tenue glamour tandis qu’ici, c’était Carmen qui se démarquait au milieu de toutes ces fashion victims.
Le metteur en scène de la pièce qui se jouerait sur la très convoitée « grande scène», Andrew Kerr, prit la parole en premier :
- Cette année; nous montons Le Conte d’hiver. Comme vous le savez sans doute, tous les dix ans, pour l’anniversaire du festival, nous consacrons notre été à Shakespeare. Or cette année, nous fêtons nos trente ans. De grands professionnels vont participer à notre projet. Alors voilà...
Il s’éclaircit la voix pour obtenir l’attention générale.
- La grande scène est réservée à une pièce jouée par des professionnels. Cependant, la tradition veut qu’un rôle soit tenu par un amateur. Un seul rôle, et généralement pas l’un des principaux. Cela se passe ainsi chaque année. Vous êtes les bienvenus aux auditions, mais il n’y aura qu’un seul élu. Ne gâchez donc pas toute votre énergie, il y a des rôles très intéressants sur la scène secondaire et dans la pièce des amateurs. Vous jouerez tous un rôle dans ce festival, de toute façon.
La plupart des participants savaient déjà tout cela, mais il était difficile de réfréner ses espoirs. Nombreux seraient ceux qui y mettraient toute leur énergie, malgré ce qu’Andrew Kerr venait de dire. Carmen commençait à se rendre compte que les acteurs, en général, avaient de grandes espérances et un amour-propre assez développé.
- Les auditions auront toutes lieu en même temps. Puis nous ferons une première sélection sous forme de liste, pour chacune des trois pièces.
Y avait-il quelqu’un d’autre dans la salle qui postulait directement pour travailler à la technique ? Carmen en doutait. Était-elle la seule à partir vaincue?
- Les auditions débuteront non pas demain, mais après-demain. Les feuilles d’inscription sont dans le hall. Bonne chance à tous !
Carmen se demandait si elle avait un espoir de travailler dans les coulisses de la grande scène. Sans doute que non. Des décorateurs et des accessoiristes professionnels se déplaçaient exprès pour ce festival. Tant pis, de toute façon, ça lui plaisait autant de travailler pour l’une des autres pièces.
Après la réunion, Julia se sentait inspirée.
- Retournons dans la chambre pour nous mettre au travail.
- Mais moi, je n’ai rien à préparer pour l’instant, remarqua Carmen, qui peinait un peu à suivre son pas énergique.
- J’espérais que tu pourrais me faire répéter mon texte.
Il y a des gens qui aiment le changement plus que d’autres. Alors que le reste du groupe s’était affalé sur les trois banquettes du vieux break - l’un des nombreux véhicules antiques de l’Association d’archéologie classique -, Bee se tenait droite comme un palmier, admirant les paysages qui défilaient entre Izmir et Priène. Ils longeaient la côte et on pouvait apercevoir la mer Égée par les fenêtres de droite,
- Éphèse se trouve à quelques kilomètres, sur la gauche, expliqua Bob Trucmuche, l’étudiant-chercheur qui conduisait la voiture. On va y passer quelques jours cet été.
Bridget plissa les yeux dans la direction qu’il lui indiquait, tentant de se remémorer les photos d’Éphèse qu’elle avait vues en cours d’archéologie. Le soleil était effectivement arrivé en même temps qu’elle.
- Il y a aussi Aphrodisias, Milet et Halicamasse. Parmi les plus belles ruines que tu auras l’occasion de voir dans ta vie.
Elle était contente de ne pas dormir, car sinon Bob n’aurait pu raconter ça à personne et elle ne l’aurait jamais su.
- Et Troie ? demanda-t-elle, le souffle court.
Jamais elle n’avait été si loin de chez elle, jamais elle n’avait mis les pieds dans un endroit aussi incroyable. Cette terre était plus chargée d’histoire qu’aucun autre endroit au monde.
- Troie est vers le nord, près des Dardanelles. C’est captivant du point de vue historique, mais il n’y a pas grand-chose à voir. Autant que je sache, dans notre groupe, il n’y a personne qui compte y aller.
Il avait un polo orange délavé et le visage rond. Il devait s’être rasé la barbe récemment car son menton et le bas de ses joues étaient plus pâles que le reste de son visage.
- J’ai lu l’Iliade à la fac, cette année, dit-elle. Enfin, le texte presque complet.
En plus de son cours d’archéologie, elle avait pris «littérature de la Grèce antique ». Elle n’en était pas vraiment consciente sur le coup, mais c’était ce qui l’avait le plus intéressée durant cette première année. On ne peut jamais prévoir ce qui peut nous marquer ou pas.
Lorsqu’ils arrivèrent sur le site, Bridget fut surprise : c’était minuscule et vraiment basique. Deux immenses tentes, entourées de quelques plus petites et, derrière, le carré poussiéreux du chantier de fouilles délimité par des cordes. Le tout était situé sur une haute colline, dominant une plaine traversée par une rivière, avec en toile de fond la mer Égée.
Elle déposa ses sacs dans l’une des tentes aux cloisons de toiles tendues sur une plate-forme en bois. Pour tout meuble, il n’y avait que quatre lits de camp et quelques étagères, mais elle trouva cela plutôt romantique. Les campements rustiques, elle avait l’habitude.
Les nouveaux arrivants, un peu abrutis par le voyage, se rassemblèrent pour la réunion d’accueil. Bridget put s’adonner à son vice préféré : chercher qui était le plus beau mec dans la pièce. C’était un vice qu’elle avait contracté avant d’être une « fille qui a un petit ami » et elle n’avait pas totalement réussi à l’éradiquer.
En l’occurrence, la pièce consistait en une grande tente ouverte sur un côté, qui leur servirait de salle de réunion, de salle de conférence et de réfectoire. On y avait surtout une belle vue sur la mer Égée, mais il y avait aussi quelques mecs pas mal.
- Nous sommes sur un site assez isolé, comme vous avez pu le remarquer. Les sanitaires sont rudimentaires : nous disposons de quatre latrines et de deux douches. C’est tout. Cet été, la transpiration sera votre meilleure amie, les encouragea Alison Machin, directrice adjointe, en guise de discours d’accueil pas très accueillant.
Bridget en déduisit qu’elle avait raté sa vocation : elle aurait dû faire carrière dans l’armée si les privations l’excitaient tant que ça.
Eh bien, elle aussi, ça l’amusait, les privations.
- Nous avons un générateur qui alimente le labo, mais les dortoirs n’ont pas l’électricité. J’espère que personne n’a apporté son sèche-cheveux.
Cela fit rire Bridget, mais pas toutes les filles.
C’était un petit chantier familial et assez récent, à ce qu’elle avait compris. Une trentaine de personnes en tout, mélange d’étudiants, de chercheurs et de quelques volontaires, « simples citoyens ». La tenue de rigueur étant T-shirt, treillis ou short en toile et Birkenstocks, on avait du mal à distinguer les professeurs d’université des doctorants, et les étudiants des simples citoyens. La plupart étaient américains ou canadiens, il n’y avait que quelques Turcs.
- Le chantier est divisé en trois parties où vous passerez tous un certain temps. Si vous êtes étudiant et que vous voulez faire valider cette expérience, vous devez assister aux conférences le mardi de trois à cinq. Nous organisons quatre excursions pour visiter d’autres sites, le planning est affiché sur le tableau. Toutes les sorties peuvent compter pour votre cursus. Voilà pour la partie universitaire. Sinon, nous sommes là pour bosser, c’est un travail d’équipe. Des questions?
Pourquoi les personnes chargées de l’organisation présentaient-elles toujours les choses de façon aussi rébarbative ? Un peu d’enthousiasme : ils allaient visiter le temple d’Artémis à Éphèse, que diable !
Heureusement que l’université Brown était située dans un cadre plutôt urbain et non dans une tente, parce qu’il était difficile de se concentrer avec la mer qui vous faisait de l’œil. Perdant le fil de ce que disait Alison, elle s’adonna à son vice préféré. L’un des plus beaux mecs devait être étudiant. Il avait les cheveux bruns, frisés et les yeux très noirs. D’origine orientale, sans doute. Peut-être turc, mais elle l’avait entendu parler anglais.
Il y en avait un autre, pas mal, plus âgé. Sans doute en doctorat. Il avait les cheveux roux et tellement d’écran total sur la figure que son visage paraissait bleu. Pas top sexy.
- Bridget, c’est ça ? lui demanda Alison, la tirant de ses rêveries coupables.
- Oui.
- Tu es au funérarium.
- OK.
Alors qu'elles allaient visiter le labo, Bridget s’approcha d’une fille qui S’appelait Karina Itabashi pour lui demander :
- C’est quoi le funérarium ?
- L’endroit où on s’occupe des morts.
- Ah...
Après le déjeuner, Bridget se rendit à sa première conférence et découvrit un fait du plus haut intérêt : le plus beau mec n’était ni le soi-disant Turc ni le roux badigeonné d’écran total. Le plus beau mec était celui qui se tenait devant elle, en train de faire un cours sur les artefacts.
- Bien...
Le plus beau mec sortit un objet de derrière son dos.
- Vous voyez ce que j’ai dans la main ? Est-ce un artefact technologique, un artefact sociologique ou un artefact idéologique ?
Le plus beau mec la fixait, attendant une réponse à sa question.
- C’est une tomate, répondit-elle.
Au lieu de lui lancer la tomate en pleine figure, le plus beau mec éclata de rire.
- Bien vu, euh...?
-Bridget.
- Bridget. D’autres propositions ?
Quelques mains se levèrent.
Lorsqu’elle l’avait vu manger un sandwich sous un olivier, un peu plus tôt dans la journée, elle l’avait pris pour un étudiant. Il ne paraissait pas avoir la trentaine. Mais il s’était présenté comme Peter Haven, professeur à l’université de l’Indiana. Donc, à moins que ce ne fût un menteur, il était prof. Elle essaya de localiser l’Indiana sur une carte.
Après le dîner dans la grande tente, ce soir-là, un petit groupe se rassembla sur un talus au sommet de la colline pour regarder le coucher de soleil. Il y avait des packs de bière par terre. Bridget s’assit à côté de Karina qui avait une canette à la main.
- Tu en veux une ? lui proposa-t-elle.
Elle hésita. Karina parut lire dans ses pensées.
- Je crois qu’il n’y a pas d’âge minimum pour boire, ici.
Elle se pencha donc pour se servir. Elle était allée à tant de fêtes cette année qu’elle avait développé une certaine sympathie pour la bière, pour ne pas dire une véritable amitié.
De l’autre côté de Karina, Bridget reconnut l’un des organisateurs. Une fois de plus, comme au dîner, elle fut frappée de voir tous les membres de l’équipe se mélanger ainsi. Il ne semblait y avoir aucune hiérarchie sur ce chantier, en tout cas pas la même qu’à la fac. Pourtant, il était très hétérogène au niveau de l’âge. Les gens paraissaient se regrouper en fonction de la section où ils travaillaient plutôt que par âge ou par statut professionnel. Elle s’aperçut alors qu’elle avait le réflexe de chercher une figure d’autorité, mais ici elle n’en avait trouvé aucune.
- C’est quoi ton secteur de fouilles? demanda-t-elle à la femme qui était assise à côté d’elle.
Si elle avait bien retenu, elle était dans sa tente et elle s’appelait Maxine.
- Je ne participe pas aux fouilles. Je suis conservatrice. Je m’occupe des poteries au labo. Et toi ?
- Au funérarium. Pour commencer, du moins.
- Ooh ! Tu as le cœur bien accroché ?
- Je crois, oui.
- Elle remarqua Peter Haven, à l’autre bout du groupe. Il était en train de rire, une bière à la main. Il avait vraiment quelque chose qui lui plaisait.
Le soleil se coucha. La lune apparut. Maxine leva sa canette et Bridget trinqua avec elle.
- Au funérarium !
- À la poterie ! répondit Bridget.
C’était la première fois qu’elle trinquait avec une conservatrice. C’était chouette d’être adulte. Même la bière avait meilleur goût qu’avant.
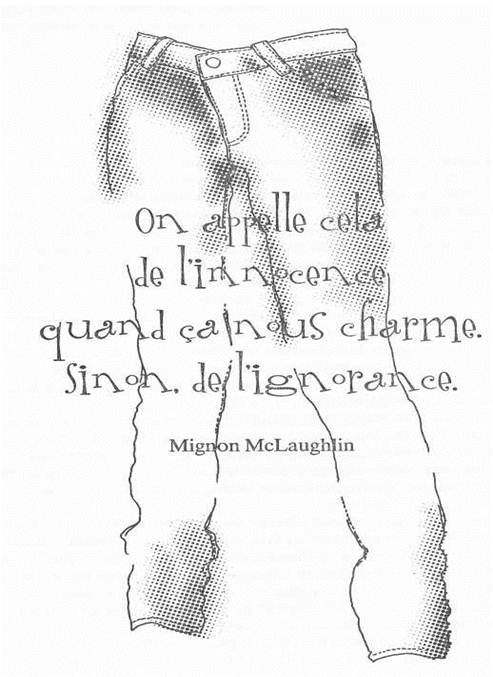
Si Léo l’avait regardée, comme prévu, Lena n’aurait pas passé la nuit à penser à lui ni cherché son nom sur Google.
Elle n’aurait sans doute pas non plus ressenti le besoin de se rendre à l’atelier un samedi matin alors que tous les étudiants dignes de ce nom étaient encore au lit. Mais elle voulait jeter un coup d’œil à son tableau, dans l’espoir secret que son talent ne fût pas à la hauteur de sa réputation.
Elle regarda d’abord son propre travail. C’était la représentation en pied d’une femme aux cuisses épaisses prénommée Nora. Lena arrivait à se convaincre de sa beauté tant qu’elle ne bougeait pas. Dès qu’elle changeait d’expression ou qu’elle ouvrait la bouche, tout s’écroulait et Lena devait repartir de zéro au début de chaque pose.
Mais, à leur façon, les cuisses de Nora dégageaient une certaine grâce et, plus important encore, confrontaient Lena avec le rapport à la masse, qu’il était si difficile de rendre en deux dimensions. Or elle était assez satisfaite de cet aspect-là de son travail.
Puis, toute honteuse bien qu’elle soit seule, elle fit quelques pas sur le lino rayé. Elle regarda l’estrade déserte, les chevalets abandonnés, les hautes fenêtres à battants grinçantes, la fougère que personne n’arrosait jamais, le tout baigné de cette odeur si particulière. Contempler un atelier vide, c’était comme contempler le monde de nuit. Il était difficile de croire qu’un endroit était le même en plein jour.
Lena se rappelait cette nuit d’orage, un été, alors qu’elle était collégienne. Comme elle ne dormait pas, elle s’était levée au milieu de la nuit et était courageusement descendue en chemise de nuit s’asseoir sur le perron pour regarder l’orage. À la lueur des éclairs, minuit était soudain devenu midi et Lena avait été frappée de constater que toutes ces choses qui constituaient le monde mystérieux de la nuit étaient en tout point semblables à ce qu’elles étaient sous la lumière prosaïque du jour.
Cette expérience l’avait convaincue que ce qu’elle voyait, ou même ce qu’elle ressentait, n’avait qu’un très vague rapport avec ce qui se trouvait là devant elle. Ce qui se trouvait là, devant elle, constituait la réalité, peu importait ce qu’elle voyait ou ressentait.
Mais lorsqu’elle s’était mise à peindre et à dessiner, elle avait dû faire le chemin inverse. Il n’y avait aucun moyen d’accéder à une réalité quelconque au-delà de ce qu’on voyait. La réalité était ce qu’on avait sous les yeux. « Nous sommes prisonniers de nos sens, lui avait un jour dit Annick, son ancien professeur. Nous n’avons rien d’autre pour accéder au monde.»
«Et donc nos sens sont le monde», avait pensé Lena à l’époque, et bien souvent depuis.
On ne pouvait pas peindre une cuisse d’après ce qu’on en imaginait, de jour ou de nuit. On ne pouvait peindre une cuisse que d’après la manière dont les particules de lumière frappaient la rétine à un certain angle, dans une certaine pièce, à un certain moment.
Pourquoi passait-elle tant de temps à désapprendre? C’était tellement plus difficile que d’apprendre, murmura-t-elle en s’approchant timidement du chevalet de Léo.
Elle avait presque peur de regarder - peur que sa toile soit moins bien réussie que prévu, mais surtout peur qu’elle soit mieux.
Elle attendit d’être bien en face d’elle pour la découvrir.
Après trois jours dans cet atelier, sa peinture n’était encore qu’une ébauche. Davantage suggestion qu’exécution. Et pourtant elle était d’une qualité tellement supérieure à la sienne qu’elle en aurait pleuré. Non pas juste parce que, en comparaison, la sienne n’était qu’un travail d’amateur, mais aussi parce que la toile de Léo avait une facture, une profondeur qui même à ce stade précoce la rendait indiciblement triste et belle.
Elle consacrait sa vie à son école d’art et elle savait qu’elle pouvait y apprendre beaucoup mais, dans un éclair de lucidité, elle se rendit compte également que personne ne pourrait lui enseigner cela. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi cette peinture la touchait autant, de quelle façon elle exprimait intimement l’essence de Nora, mais elle le sentait. Et elle voyait du même coup ses espoirs et ses ambitions réduits en miettes. Elle les entendait presque se briser en menus morceaux.
Elle s’essuya les joues d’un revers de main, agacée de les sentir humides. Elle aurait préféré que les larmes qui lui montaient aux yeux soient du genre virtuel, et non du genre bêtement mouillé.
Elle se représenta Léo. Ses cheveux et sa main. Elle essaya de relier cette image à la peinture qu’elle venait de découvrir.
Et soudain elle eut honte de son petit jeu stupide, réalisant que ses pensées seraient dorénavant occupées par lui quelle que soit la façon dont il la regarderait, si jamais il posait ses yeux sur elle un jour, d’ailleurs.
LennyK162 : Hellooooo, Tibby, Tu es là ? Tu ne réponds pas au téléphone, on commence à s’inquiéter. Bee a l’intention d’aller signaler ta disparition à la police et je suis chargée d'appeler Alice. Je t’en prie, fais-nous signe !
Tiboudou : Je suis là, ô hilarante amie !
- S’il te plaît, rappelle-moi avant cinq heures si tu peux, Tib.
Tibby s’allongea sur son lit en écoutant la fin du message de Brian. Elle n’avait pas envie de le rappeler. Si elle lui parlait en personne au lieu de lui laisser des messages lorsqu’elle savait qu’il était au travail, elle ne parviendrait sans doute pas à rester en colère après lui.
- Tout va bien se passer, Tib, disait-il en conclusion.
Pourquoi répétait-il ça tout le temps ? Avait-il le pouvoir de faire que tout aille bien ? Peut-être que, justement, non, ça n’allait pas bien se passer. Peut-être qu’elle était vraiment enceinte.
Et de toute façon, pour qui était-ce censé bien se passer, hein ? C’était son corps, à ce qu’elle sache, pas le sien.
Et si elle était enceinte, hein ? Qu’est-ce qu’il répondrait à ça ? Et s’il voulait garder le bébé ? Il avait déjà évoqué le sujet, avant. Si ça se trouve, il espérait secrètement qu’elle soit enceinte...
Méta-Tibby avait un commentaire à faire, mais Tibby simple mortelle la fit taire.
Brian idéalisait sans doute le fait d’avoir un enfant. Il devait penser que ce serait quelque chose de merveilleux, un lien unique entre eux. Eh bien, Tibby avait déjà assisté à tout le processus en direct et ce n’était pas beau à voir. Elle se souvenait de l’énorme ventre de sa mère quand elle attendait Nicky, tigré d’affreuses marques de vergetures. Elle savait qu’avec un bébé, il ne fallait pas compter dormir, ça pleurait tout le temps. Et, au cours d’une des expériences les plus surréalistes de sa vie, elle avait carrément été plongée, bien malgré elle, au cœur de cette affaire sanglante en aidant Christina à accoucher. La naissance était un événement d’une telle puissance, pure beauté et pure terreur à la fois ! Elle était bien la dernière fille au monde à pouvoir se dire qu’avoir un bébé, c’était mignon et sexy.
Donc ça ne pouvait pas lui arriver, impossible. Mais... ?
Si ses dernières règles dataient du cinq... ou était-ce le six ? Après, il fallait compter vingt-huit jours... Non, vingt et un, c’était bien ça ? À partir du dernier jour... ou bien du premier ?
Tibby s’était posé toutes ces questions des centaines de fois et elle bloquait toujours aux mêmes endroits.
Le mercredi soir, Brian travaillait comme serveur dans un restaurant mexicain de Rockville. Elle attendit qu’il prenne son service pour le rappeler.
- Tu ferais mieux de ne pas venir ce week-end. Je vais peut-être aller voir Lena à Providence. OK ? Désolée.
Bile s’empressa de raccrocher. Elle devait faire une tête bizarre, son visage était tout crispé. Mais elle était trop préoccupée en ce moment pour avoir honte de mentir ou même se soucier d’être crédible.
Si c’était le cinq, alors ses règles - si elle les avait - devraient arriver vers le vingt-six. Mais si ce n’était pas le cinq? Ça pouvait tout aussi bien être le six ou le sept. Alors il faudrait qu’elle attende jusqu’à dimanche. Comment allait-elle tenir jusque-là?
Et si elle ne les avait pas dimanche ? Et si elle ne les avait pas du tout ?
Non. Elle ne pouvait même pas l’envisager. Elle ne pouvait pas aller au bout du raisonnement et, en même temps, elle était incapable de penser à autre chose.
Elle n’avait aucune intention de se rendre à Providence. Elle n’avait aucune envie de voir ses amies en ce moment. Pas avant d’avoir eu ses règles. Si elle les voyait, elle serait obligée de leur raconter ce qui lui arrivait. Elles la connaissaient trop bien pour se contenter de réponses évasives ou pour avaler ses mensonges. Elle ne voulait pas prononcer le mot tant redouté devant ses amies pour ne pas le rendre trop réel.
Elle s’en voulait de ne pas pouvoir leur dire que ça y était, qu’elle avait sauté le pas. Elle avait besoin de le leur raconter, c’était trop important. Mais les conséquences qui en découlaient étaient bien trop pénibles pour qu’elle ait envie d’en parler. Tout ça était trop imbriqué.
Elle n’avait pas envie de voir Brian non plus. Elle ne voulait pas parler de ce qui s’était passé. Et s’il voulait à nouveau faire l’amour ? Il voudrait, c’était sûr. Que répondrait-elle alors ?
«Brian n’aurait pas dû insister autant, se surprit-elle à penser. On aurait dû rester comme on était.»
Elle n’avait pas faim, elle n’avait pas sommeil. Rien ne lui faisait envie, rien ne lui faisait plaisir. Elle n’avait envie de rien faire.
Pourtant, elle avait un programme très précis pour ce week-end. Attendre et espérer la seule chose qu’elle souhaitait vraiment. Attendre et espérer les avoir.
- Oh, mon Dieu ! C’est un fragment de crâne. Que quelqu’un aille chercher Bridget.
Bee se retourna en riant.
Darius, le bel Oriental, se révéla non pas turc mais d’origine iranienne et vivant à San Diego. Il travaillait aussi au funérarium et, à cet instant précis, était en train de désigner un mur de terre.
Elle s’approcha. Troqua son habituelle truelle pointue pour un instrument plus fin. En un peu plus d’une semaine, elle avait acquis la réputation d'être sans peur. Os en décomposition, serpents, vers, rongeurs, araignées, insectes de toutes tailles ne l’effrayaient pas. Même la puanteur des latrines ne la perturbait pas. Sauf qu’en réalité elle n’allait pratiquement jamais faire pipi là-dedans.
À cinq heures et demie du soir, ses collègues sales et en sueur regagnèrent le camp, alors qu’elle était encore en train de dégager ce fragment d’os. Il était assez gros et c’était un travail minutieux. On ne pouvait pas le déterrer comme ça. Il fallait nettoyer et examiner chaque grain de terre avec soin. La moindre brisure d’os, le moindre éclat de poterie ou de pierre devait être envoyé au labo. Et la position de chaque chose devait être précisément notée sur une grande grille en trois dimensions. Enfin, il fallait tout photographier avec un appareil numérique avant de numéroter chaque pièce.
- La différence entre le pillage et l’archéologie, c’est que nous prenons soin de préserver le contexte, lui avait expliqué Peter. L’objet en lui-même, quelle que soit sa valeur, ne représente qu’une infime parcelle de la valeur qu’il a pour nous en contexte.
À six heures et demie, Peter était encore avec elle.
- Tu peux y aller, lui dit-elle. J’ai presque fini.
- Ça m’embête de te laisser seule dans une tombe, répondit-il.
Il lui plaisait comme ça, avec le soleil dans le dos. Elle le laissa rester.
- Je l’ai baptisé Hector, dit-elle en tirant avec précaution le crâne de la terre.
- Qui?
- Lui, fit-elle en montrant le trou où se tenait autrefois son nez.
- Un nom de héros. Pourquoi penses-tu que c’était un homme ?
Elle ne savait pas s’il lui posait réellement la question ou s’il la testait.
- À cause de sa taille. On a trouvé un fragment de crâne de femme hier.
Il hocha la tête.
- Et tu l’as appelée comment ?
- Clytemnestre.
- Pas mal.
- Merci. Je cherche encore ses derniers restes. Son squelette est presque entier.
- Oh, c’est elle, alors. J’en ai entendu parler au labo.
Bridget hocha la tête.
- Ceux qui font de la bio sont tout excités.
Une fois qu’elle eut presque ôté toute la terre, elle prit doucement le crâne d’Hector entre ses mains et entreprit de brosser les cavités comme on le lui avait appris.
- Ça ne te fait rien, hein ?
Elle haussa les épaules.
- Pas vraiment.
- À un moment quelque chose va finir par te toucher, c’est obligé. Tout ça paraît tellement lointain, je sais, mais il y a toujours quelque chose qui finit par nous atteindre.
- Mais qu’un gars soit mort il y a plus de trois mille ans n’a rien de tragique, non ? murmura Bridget. Ce bon vieil Hector serait de toute façon mort depuis longtemps quelles que soient les choses extraordinaires ou terribles qui lui sont arrivées au cours de sa vie.
Peter lui sourit.
- Ça permet de prendre du recul par rapport à la mort, pas vrai ?
- Ouais. Pourquoi tant s’inquiéter à propos de tout alors qu’on va tous finir comme ça?
Elle était d’humeur plutôt joyeuse pour quelqu’un qui se trouvait sur un site funéraire avec un gros fragment de crâne humain à la main.
Il se mit à rire, visiblement sous le charme. Il s’assit au bord de la tranchée pour réfléchir. Décidément, il avait l’ouïe extrêmement fine. Il entendait toujours tout ce qu’elle disait et la comprenait parfaitement, qu’elle parle fort ou qu’elle marmonne entre ses dents. Quand on partage le même contexte, ça facilite la compréhension.
- C’est sûr qu’une mort récente paraît plus tragique, reprit-il. Sans doute parce que nous sommes encore dans le monde où cette personne n’est plus. Nous restons avec le vide, le manque qu’elle a laissé.
Avait-il déjà vécu pareille tragédie? se demanda-t-elle. Se doutait-il qu’elle en avait fait l’expérience ?
Elle repoussa ses cheveux en arrière, barrant son front d’une traînée de terre.
- Notre lien moral aux autres se distend au bout d’un certain temps, tu ne crois pas ? Sinon, comment pourrions-nous fouiller dans leur tombe ?
- Tu as parfaitement raison, Bridget. Je suis 100 % d’accord. Mais au bout de combien de temps? Deux cents ans? Deux mille? Comment estimer au bout de combien de temps la mort d’un être humain cesse d’être une affaire de sentiments pour devenir un fait scientifique ?
Elle savait qu’il s’agissait d’une question rhétorique, mais elle avait tout de même envie d’y répondre.
- Je dirais à partir de la disparition de la dernière personne qui a été un contemporain du mort. De sorte que celui qui est décédé n’a plus la possibilité d’apporter quoi que ce soit au monde des vivants, joie ou chagrin.
Il sourit devant tant d’assurance.
- C’est ton hypothèse ?
- Oui, c’est mon hypothèse.
- Mais tu ne crois pas que quelqu’un peut causer de la joie ou du chagrin bien après sa mort ?
- Non, pas si ceux qui l’ont connu sont tous morts, répondit-elle presque par réflexe.
Parfois, la certitude exerçait sur elle davantage d’attrait que la vérité. -Alors, mon amie, les Grecs ont un ou deux trucs à t’apprendre.
Lenny,
Voici le jean magique garni d’un peu de terre antique, ainsi qu’une photo de moi en compagnie de mon nouveau petit ami, Hector. Pas très vif, me diras-tu. Mais il a l’expérience de l’âge !
Bisous de ton amie Bee (et un gros baiser édenté d’Hector)
Carmen aida Julia à répéter son texte. Pendant des heures et des heures, deux jours durant. Julia voulait essayer différents personnages avant de définir sa stratégie pour l’audition.
Carmen fut soulagée lorsqu’elle sortit photocopier encore d’autres rôles, ce qui lui laissa le temps de souffler et de consulter ses mails. Elle avait plusieurs nouveaux messages de Bee, de Lena, de sa mère et de son demi-frère, Paul.
Lorsque Julia revint dans la chambre, elle remarqua immédiatement la photo que Carmen avait imprimée et posée sur son bureau.
- Hé, c’est qui?
Elle prit la feuille pour mieux la regarder.
C’était une photo de Bee en Turquie. Elle avait un crâne à la main et faisait semblant de l’embrasser. Carmen l’avait reçue par mail et ça l’avait tellement fait rire qu’elle l’avait imprimée.
- C’est mon amie Bridget, expliqua-t-elle.
- Ah bon?
- Ouais.
Elle ne parlait pas souvent de ses amies à Julia, elle se rendait bien compte que c’était bizarre. Elle les mentionnait comme ça en passant, mais elle ne montrait jamais à quel point elles étaient proches. Elle ne savait pas pourquoi. Comme si elle avait rangé ses amies et Julia dans différents compartiments de sa vie qui ne se mélangeaient pas. Elle ne voulait surtout pas qu’ils se mélangent.
- C’est une amie à toi ?
Julia avait l’air incrédule, sous-entendant presque que Carmen avait découpé la photo dans un magazine et inventé cette histoire.
« C’était peut-être là l’explication, justement », pensa Carmen.
- Elle est canon ! Regarde-moi ces jambes, s’extasia Julia.
- C’est une sportive.
- Elle est belle. Elle va à quelle fac ?
C’était drôle, Carmen n’avait jamais considéré Bee comme belle. Bee n’avait pas la patience d’être belle.
- Brown, répondit-elle.
- J’avais pensé m’y inscrire. Mais Williams est bien plus intello.
Remarque pertinente pour une fille qui ne manquait pas un numéro de
Voici, Gala et compagnie. Carmen haussa les épaules.
- Ses cheveux sont trop blonds, ça fait faux. Elle devrait se faire une couleur plus foncée.
- Quoi?
- Elle les fait elle-même, ses couleurs ?
- Bridget ? Mais elle ne se teint pas les cheveux. C’est naturel.
- C’est sa couleur naturelle ?
- Oui.
- Tu es sûre?
- Oui !
- Mmm, c’est ce qu’elle te fait croire, répliqua Julia en plaisantant à moitié, mais Carmen ne trouvait pas ça drôle.
Elle dévisagea Julia, tentant de comprendre ce qui se passait dans sa tûte. Pouvait-elle être jalouse d’une fille qu’elle n’avait jamais rencontrée ?
- Tiens, si on allait se chercher un petit truc rapide pour manger dans la chambre, ce soir ? suggéra Julia un peu plus tard, après une autre heure à réciter ses textes. J’aimerais continuer à travailler.
- Tu n’as qu’à rester ici, proposa Carmen. Je vais y aller.
Elle était franchement contente de pouvoir s’échapper cinq minutes, de prendre l’air, d’oublier les textes. Le cadre de la fac était vraiment enchanteur, surtout dans la lumière du soir. Il y avait de petits saules le long des allées et d’immenses parterres de fleurs autour des bâtiments.
Absorbée dans la contemplation du paysage, Carmen s’était égarée. Elle ne savait plus où se trouvait la cafétéria, surnommée la «cantine» par les stagiaires. Elle marcha jusqu’au sommet d’une colline dominant la vallée, elle était verdoyante et si jolie dans cette lumière dorée...
Carmen resta là un long moment. Elle était déjà perdue, elle ne pouvait pas se perdre davantage, de toute façon. « Quand on est chez soi nulle part, on est chez soi partout », murmura-t-elle.
Cela faisait tellement longtemps qu’elle n’avait pas admiré quelque chose de beau. Comme si ses sens avaient été gelés toute l’année et se réveillaient seulement.
Elle s’aperçut alors qu’il y avait quelqu’un près d’elle, qui admirait le même paysage. C’était une femme qu’elle n’avait encore jamais croisée.
- C’est beau, hein? dit-elle.
Carmen soupira.
- Oh, que oui !
Elles reprirent le chemin ensemble.
- Tu participes au festival de théâtre ? lui demanda la femme.
Elle avait les hanches larges et manquait de grâce. Ce n’était sûrement pas une actrice, se dit Carmen, aussitôt mue par un élan de sympathie.
Elle hocha la tête.
- Tu vas auditionner pour quelle pièce ?
Carmen glissa une mèche de cheveux derrière son oreille.
- Aucune. Je m’occupe des décors, en fait.
- Tu ne vas pas passer d’audition?
- Non.
- Pourquoi?
- Parce que je ne suis pas actrice.
- Comment peux-tu le savoir ? Tu as déjà essayé ?
Euh, je ne crois pas. Non.
«Mais mon père assure que j’ai un certain sens théâtral», ajouta-t-elle pour elle-même.
- Tu devrais essayer. C’est tout l’intérêt de ce festival.
- Vous croyez?
- J’en suis sûre.
- Mmm.
Carmen fit semblant d’y réfléchir deux secondes, par pure politesse.
- Pourriez-vous m’indiquer la direction de la cantine ? Je me suis perdue et je n’ai aucune idée d’où je vais.
- Par ici.
La femme tendit le bras vers la gauche à un croisement.
- Merci, fit Carmen en se retournant.
- Comment t’appelles-tu ?
- Carmen.
- Moi, c’est Judy. Ravie d’avoir fait ta connaissance Carmen. Et présente-toi aux auditions, d’accord ?
Carmen ne pouvait pas dire oui si ce n’était pas vrai.
- Je vais y réfléchir.
- C’est tout ce que je te demande, répondit la femme.
Plus tard, alors que Carmen sombrait dans le sommeil, hantée par des bribes de réplique, elle réfléchit effectivement à la question et comprit pourquoi elle ne se présenterait pas.

Lena faisait les cent pas, complètement survoltée. Elle n’aimait pas être dans cet état. Elle avait oublié de manger et s’était maquillé les yeux pour venir au cours. Elle ne s’autorisait à regarder Léo qu’une seule fois au cours de chaque séance de pose et s’obligeait à rester seule pendant les cinq minutes de récréation qui les séparaient. Elle espérait elle priait silencieusement pour qu’il la remarque. Et elle faisait tout son possible pour ne pas compromettre ses espoirs et les protéger jalousement.
Elle voyait son propre travail d’un nouvel œil, désormais. Au début, elle était tellement écœurée qu’elle osait à peine regarder sa toile. Puis elle s’était calmée. Elle s’était efforcée de se détendre pour mieux voir, voir plus au fond des choses que d’habitude. Elle avait l’impression d’être un coureur qui vient de réussir à battre son record et apprend qu’un autre a fait deux fois mieux que lui. Si une telle intensité d’expression existait, il fallait qu’elle pousse plus loin ses possibilités. Il fallait au moins qu’elle essaie.
Léo occupait ses pensées. Elle se renseigna à droite, à gauche, l’air de rien - tout du moins elle l’espérait - et apprit qu’il était en troisième année, qu’il ne logeait pas sur le campus et participait rarement aux divers événements qui y étaient organisés. Ce qui ne fit qu’accentuer son aura mystérieuse.
Le samedi suivant, le paquet de Bee contenant le jean magique arriva. Lena le mit pour se donner du courage et oser quitter le cocon rassurant de sa chambre universitaire - pas le courage d’aborder Léo, non, simplement de retourner voir sa toile.
Elle était tellement déterminée, surexcitée et en même temps gênée, qu’elle avait presque l’impression de pénétrer dans l’atelier désert pour commettre un vol. Elle passa devant son chevalet en ignorant sa propre peinture, filant directement voir la sienne. Elle se planta devant, comme elle avait eu tant envie de le faire toute la semaine. Chaque fois qu’elle le voyait travailler dessus, elle aurait voulu pouvoir le regarder, observer comment il s’y prenait. Comment pouvait-elle maintenant reconstituer une semaine entière de travail?
Il aurait fallu qu’elle mette autant d’ardeur à sa propre toile, mais pour l’instant elle se laissait envahir par les nouvelles perspectives qu’il lui avait fait entrevoir.
Si elle avait pu se faufiler à l’intérieur même du tableau, elle n’aurait pas hésité, elle voulait tellement comprendre ce qu’il faisait, comment il faisait.
- Dans une école d’art, on apprend beaucoup en regardant simplement autour de soi, lui avait dit Annik au téléphone quelques jours plus tôt.
Rien n’aurait pu être plus vrai. Elle regrettait de ne pas pouvoir entendre ce que le prof, Robert, disait à Léo lorsqu’il lui parlait.
La toile semblait perdre de sa beauté au fur et à mesure qu’elle la disséquait, qu’elle l’analysait. Mais, soudain, elle se laissait déconcentrer, et sa force la frappait à nouveau. Finalement, elle prit un peu de recul, laissa sa vue Se brouiller légèrement et se perdit dans sa contemplation.
Elle avait pourtant déjà vu des peintures vraiment transcendantes auparavant. Elle avait même admiré des œuvres bien plus abouties que celle-ci. Elle était allée à la National Gallery une bonne centaine de fois. Elle avait visité le Met et d’autres musées célèbres, petits ou grands.
Mais Léo était en train de peindre exactement le même sujet qu’elle, dans le même atelier, avec la même lumière. C’était un étudiant en art, pas un grand maître. Ils étaient à égalité, confrontés aux mêmes courbes, fossettes, poils et ombres, ce qui lui permettait d’apprécier la qualité de son travail avec davantage d’acuité et d’humilité.
À nouveau, elle y jeta un regard. La ligne des épaules. Les coudes. Bizarrement, elle pensa à son grand-père. Des émotions qu’elle gardait d’ordinaire bien enfouies refirent surface. Elle sentit ses joues s’empourprer et les larmes lui monter aux yeux. Puis elle pensa à Kostos et réalisa qu’elle n’avait pas pensé à lui depuis plusieurs jours.
Et si Carmen avait raison ? Peut-être était-elle capable de l’oublier. Devait-elle s’efforcer de l’oublier ?
Elle n’en était pas sûre. C’était vraiment perturbant. Elle n’était pas sûre de vouloir l’oublier, même si elle en était capable, finalement. Si elle oubliait Kostos, elle craignait d’oublier la plus grande partie d’elle-même en chemin. Qui serait-elle sans lui ?
- Qu’est-ce que tu en penses ?
Lena était si profondément plongée dans ses pensées qu’elle eut l’impression de devoir parcourir des kilomètres pour revenir à l’instant présent. Peu à peu, elle réalisa que Léo se tenait à quelques mètres d’elle, qu’il était en train de lui parler, qu’elle était plantée devant sa toile sans aucune explication valable à fournir et, en plus, en larmes.
Aussitôt, elle porta la main à son visage pour s’essuyer. Elle frotta ses doigts mouillés sur son pantalon, avant de se rappeler qu’elle portait le jean magique. Tant pis. Ce ne serait pas les premières larmes à sécher sur ce jean.
Léo la regardait tandis qu’elle se creusait la tête pour essayer de savoir ce qui était censé se passer. Il examina son jean. Fallait-il qu’elle se justifie? Il venait de dire quelque chose, non? Il lui avait posé une question. Elle était donc censée y répondre, n’est-ce pas ? Les pensées se bousculaient dans sa tête de manière si chaotique qu’elle craignait qu’il ne les entende s’entrechoquer.
- Je comprendrai si tu n’aimes pas, dit-il d’un ton conciliant.
- Non ! J’adore ! fit-elle en criant presque.
- La tête me pose problème.
Il tendit la main et, à la grande horreur de Lena, effaça du bout du pouce la peinture humide qui constituait la mâchoire de Nora.
- Non ! explosa-t-elle.
Pourquoi lui criait-elle dessus ? Elle se força à se taire. Elle n’avait aucune envie qu’il la fixe comme ça.
- Désolée... Je... C’est juste que ça me plaisait comme c’était, c’est dommage de l’effacer.
Peut-être était-elle plus en phase avec sa toile que lui-même.
- Oh... D’accord.
Il pensait qu’elle était folle. Elle préférait encore qu’il l’ignore.
Elle s’efforça de se calmer. Si elle n’arrivait pas à prendre un air détaché, alors autant être franche.
- J’aime vraiment beaucoup ta toile. Je la trouve très belle, dit-elle d’une voix plus posée, cette fois.
Il la regardait différemment, maintenant, essayant de jauger son ton, surpris par sa sincérité.
- Eh bien, merci.
- Le souci, c’est que.., quand je la regarde, je me rends compte que, moi, je ne sais absolument pas où je vais.
Qui aurait pu croire que Lena allait réellement parler à Léo ? Et qu’elle serait tellement désarmée qu’elle n’aurait d’autre choix que d’être sincère?
Il se mit à rire.
- Moi, quand je la regarde, je me rends compte que je n’ai aucune idée d’où je vais non plus.
Elle rit également, mais d’un rire désespéré.
- Oh, arrête!
Elle venait juste de lui dire de se taire, non ?
- C’est vrai, je t’assure. Je la regarde d’une certaine façon et je ne vois que ce qui cloche. On est tous pareils, hein ?
- Oui, mais pour la plupart d’entre nous, c’est vrai, répondit-elle tranquillement.
Alors, ça y était, elle était en train de discuter avec Léo !
Il rit à nouveau. Il avait un joli rire.
- Je m’appelle Léo. Tu es installée où ?
Elle désigna le chevalet qui se trouvait à l’autre bout de la pièce, tout en s’efforçant de ne pas être dévastée à l’idée qu’il ne l’ait pas remarquée jusque-là.
- Lena, annonça-t-elle d’une voix où pointait l’abattement.
- Tu es ici toute l’année ou seulement pour l’été ?
- Toute l’année. Enfin, je viens juste de finir la première.
Il hocha la tête.
Enfin, elle prit pleinement conscience de la portée de ce qu’elle était en train de vivre. Elle discutait avec Léo. Dans un atelier désert. Avait-il une petite amie ? Ou un petit ami ? Avait-il seulement le temps de se livrer à des activités aussi futiles ?
Elle se rendit alors compte qu’il avait envie de travailler à sa toile. Brusquement gênée, elle perdit tous ses moyens. Bafouillant une excuse, elle prit la fuite.
Une fois dans sa chambre, elle se tourna et se retourna dans son lit défait pendant un moment avant d’appeler Carmen.
- Devine quoi?
- Quoi?
- Je crois que je suis amoureuse.
Carma,
Voici le jean magique ainsi qu’un petit portrait de Leo. Je l’ai dessiné de mémoire, pas sur le vif, bien sûr. (Non, non, je ne pense pas à lui jour et nuit. Heureusement.)
Sacré touffe de cheveux, hein ?
Il ne s’était même pas aperçu que j’étais dans son cours. Il faut croire que je fais grande impression autour de moi !
Bisous,
Len
À sept heures et demie, le jour commençait à baisser et Peter était toujours assis au bord de la tranchée avec Bridget. Elle savait qu’il se sentait obligé de rester en tant que responsable des fouilles et aussi pour lui montrer qu’il appréciait qu’elle prenne ce travail à cœur. Elle espérait seulement qu’il passait un aussi bon moment qu’elle.
- Hé, Bridget ? dit-il enfin.
- Ouais?
- Si on allait manger ?
- Ah oui, oui.
Elle feignit l’impatience.
- Je finis juste d’enregistrer les pièces.
- On les déposera au labo en passant.
Ils se mirent en route d’un pas tranquille. En voulant s’essuyer le visage, elle rajouta une traînée de terre.
- Tu voudrais bien m’appeler Bee ?
- Bee?
- Oui, Bee l'abeille, c’est mon surnom.
- OK.
- Mes amis m’appellent comme ça. Tu peux continuer à m’appeler Bridget, mais j’aurais l’impression que tu es en colère après moi.
Il lui sourit.
- D’accord, alors ce sera Bee.
Ils se nettoyèrent en vitesse à la pompe à eau mais, lorsqu’ils arrivèrent à la grande tente, le dîner était déjà desservi.
- C’est ma faute, reconnut-elle.
- Tout à fait, acquiesça-t-il avec humour.
Les dames turques qui s’occupaient des repas leur dénichèrent gentiment du pain, de l’houmous et de la salade qui restaient. L’une d’elles leur apporta une bouteille de vin rouge fort sans étiquette. C’était risqué de boire après avoir travaillé en plein soleil toute la journée. Bee coupa le sien avec de l’eau.
Elle se demanda un instant si la situation avait quelque chose de gênant.
Non, ce n’était pas vraiment gênant, c’était plutôt amusant, et excitant. Il était beau, gentil et il lui plaisait pour tout ça et sans doute d’autres raisons.
Aurait-ce été moins gênant s’il avait été moins beau et moins gentil? Aurait-ce été moins amusant?
Oui, mais il ne fallait pas qu’elle oublie qu’elle était désormais une «fille qui a un petit ami». Et qu’il était... quoi, d’ailleurs ?
Le fait d’avoir un petit ami était-il censé vous empêcher d’être attirée par d’autres personnes ? Et vous rendre moins attirante ?
Elle se demandait ce qu’il pensait d’elle. Cette tension entre eux quand ils se penchaient pour prendre quelque chose ou qu’ils se retrouvaient l’un près de l’autre, était-ce seulement dans sa tête?
Oh ! Elle aurait voulu se gifler. Elle était incorrigible. Pourquoi se mettait-elle dans cet état?
Mmm... Est-ce qu’elle l’était vraiment d’abord ?
Et puis, c’était quoi, exactement, ce fameux état ?
Le soleil était couché depuis longtemps, mais ils se promenèrent sur la colline, jusqu’au point de vue. Le vin lui tournait un peu la tête. Et lui, était-il un peu plus gai, un peu moins sous contrôle? Ils voulaient rejoindre les autres, comme tous les soirs, mais le petit groupe s’était déjà dispersé. Ils hésitèrent à s’asseoir, gênés. Enfin, elle tout du moins. Il s’assit et elle l’imita. C’était bizarre, non, qu’ils passent autant de temps tous les deux comme ça.
Non, pas du tout, c’était elle qui était incorrigible.
Incorrigiblement, elle ôta l’élastique qui attachait ses cheveux. De toute façon, sa queue-de-cheval était à moitié défaite, se justifia-t-elle sans trop y croire elle-même. Ses cheveux étaient plus longs que d’habitude car, depuis qu’elles étaient en fac, Carmen n’était pas là pour les lui couper. Ils lui tombaient presque au niveau des coudes, au milieu du dos. Et ils possédaient la particularité de briller au clair de lune. Il allait forcément le remarquer, elle le savait. Il regrettait sans doute de s’être assis là, avec elle.
Pourquoi se comportait-elle ainsi? Elle avait grandi. Elle avait compris la leçon. Qu’essayait-elle de prouver ?
Elle sentait ce picotement familier dans ses jambes. Elle ne pouvait pas s’en empêcher.
Ou alors tout était dans sa tête ?
Oui, oui. Et tant mieux.
Elle voulut voir ses yeux pour pouvoir juger honnêtement ce qui se jouait entre eux mais, à sa grande surprise, il croisa son regard. Ils restèrent les yeux dans les yeux un peu trop longtemps avant de se détourner.
Merde.
Il s’agita. Joignit les mains comme s’il allait présente! la conclusion d’un discours.
- Alors, Bridget, parle-moi un peu de ta famille.
Elle sentit son corps s’écarter de lui sans pourtant bouger réellement.
Elle n’avait rien à dire sur sa famille.
- Alors, Peter, répliqua-t-elle avec un ton un peu trop agressif; si tu me parlais de la tienne.
L’atmosphère s’était soudainement rafraîchie. Dans ces régions sèches, le soleil se couchait en emportant toute la chaleur. Il n’y avait aucune humidité dans l’air pour la retenir.
- Voyons. Mes enfants ont quatre et deux ans. Sophie et Miles.
Ses enfants avaient quatre et deux ans. Sophie et Miles. Peut-être aurait-il pu annoncer cela en dernier plutôt que de but en blanc ? Bêtement, elle avait cru qu’il commencerait par ses parents ou ses frères et sœurs. Elle rembobina ses pensées. S’il avait des enfants, il avait donc sans doute une femme.
- Et ta femme?